

|
Histoire Naturelle > Le furet dans l'Histoire > Histoire de l'Art > Documentation > Liens > La page d'Ulysse > A propos... |


| Histoire de l'Art | |
| La Galerie d'Art du Furet | > Beaux-arts |
| Brocante du Furet | Muséologie > Héraldique > Numismatique > Philatélie > Cartophilie > B.D. > Arts Déco > Spectacles > Cinéma |
LA BROCANTE DU FURET
Sous ce titre irrespectueux, se dissimule une commodité de présentation : encore plus que sur la page précédente d'Histoire de l'Art, c'est une partie fourre-tout regroupant en négatif "tout ce qui n'est pas Beaux-arts". En une demi-douzaine de chapitres, vous trouverez pêle-mêle les arts mineurs, les expressions artistiques contemporaines ou populaires de représentation du furet... parfois les plus inattendus !
![]() : Et oui, forcément ! Les méandres des musées d'arts, on en
parlera ailleurs sur ce site ; mais avec les muséums d'histoire naturelle, les
musées sur la Chasse sont clairement ceux qui permettent le plus d'entrevoir le
furet et ses relations avec l'homme. Pour la France,
nous avons trois musées cynégétiques dont des
pièces " furet " ne figurent pas toutes sur le site.
: Et oui, forcément ! Les méandres des musées d'arts, on en
parlera ailleurs sur ce site ; mais avec les muséums d'histoire naturelle, les
musées sur la Chasse sont clairement ceux qui permettent le plus d'entrevoir le
furet et ses relations avec l'homme. Pour la France,
nous avons trois musées cynégétiques dont des
pièces " furet " ne figurent pas toutes sur le site.
Le plus imposant est le Musée International de la Chasse de Gien (Loiret), il faut dire qu'il occupe tout simplement le Château de Gien ! Et un vrai, de château, fait à la fin du Moyen-Age pour Anne de Beaujeu, régente du royaume de France. Et il a 50 ans d'existence. En ce qui nous concerne, c'est par exemple un musée qui nous permet de voir des muselières pour furet, qui nous semblent tellement étranges aujourd'hui. o) Trois pièces sur le furet sont visibles des visiteurs :
|
|
Bronze : Muselière pour furet, début XX° Siècle. Mus. Intern. Chasse de Gien, coul. 1° étage, n° MIC 70-53-1. 2,7 cm x 3. |
|
|
Fragment de toile de Jouy imprimée. 1840 Mus. Intern. Chasse de Gien, coul. 1° étage, n° MIC 84-5-1. Fragt total : 57x75,5 cm. |
|
|
Couverts : Assiette en faïence de Gien ; fin XIX° s Musée Intern. de la Chasse, couloir du 1° étage, n° MIC 86-4-1. Diamètre : 20 cm. |
Les muselières pour furet, il en est question sur d'autres chapitres du site (modèle métallique du XIX° Siècle) ou vous en avez une photo d'un modèle cuir du XX° Siècle dans le guide britannique Complete guide to ferrets de James MacKay, et toujours en relation avec la chasse (c'est toujours plus civilisé que de limer les dents !).
Vous
ne voyez pas le rapport entre le furet et la station de métro parisienne
Oberkampft ? Il y en a un : la toile de Jouy. Si le nom n'est pas forcément
connu, en réalité la plupart des gens en ont déjà vu une fois ; c'est un
style de toile imprimée qu'on trouve dans les magasins de tissus pour les
nappes, coussins et rideaux et qui représentent des scènes (en monochrome sur
fond clair) bucoliques du XVIII° Siècle du style la bergère et son galant à
côté d'un moulin (et n'oublions pas les moutons o).
Et la faïence de Gien, c'est
quoi ? Une production de faïence fine à décor imprimé, (manufacture fondée
en 1822) qui est encore vivante aujourd'hui. Les anciens modèles de vaisselle
les plus recherchés sont vertes à fond noir ou carrément polychromes, mais
ont coexistés là-bas et une production de faïences populaires et une
production de faïence d'art ; les deux sont visibles au Musée de la
faïencerie de Gien. La faïence est souvent confondue avec la porcelaine, ou
vue comme une "porcelaine du pauvre" : en réalité la matière est
différente. Pour voir la différence entre les deux, cassez une assiette de
faïence puis une assiette de porcelaine o) : sur la tranche, la porcelaine sera
intégralement blanche, et la faïence sera blanche en surface et écru à
l'intérieur ! Voilà le truc, la faïence est de la poterie émaillée dessus ;
si son nom est de la Renaissance italienne, c'est une invention de l'
Pour avoir les images de tout cela, une petite visite là-bas s'impose : affaire à suivre...
![]()
La Maison de la Chasse et de la Nature de Paris (Hôtel Guénegaud)
est au 60 rue des archives dans le très recherché aujourd'hui III°  Arrondissement.
C'est l'une des deux composantes du musée de la chasse de la Fondation (ce
n'est pas des musées public) avec le
Musée de la Chasse de l'Art animalier abrité lui au 2° étage du Château de
Chambord.
Arrondissement.
C'est l'une des deux composantes du musée de la chasse de la Fondation (ce
n'est pas des musées public) avec le
Musée de la Chasse de l'Art animalier abrité lui au 2° étage du Château de
Chambord.
avec deux oeuvres :Le musée est essentiellement un musée d'art. Les techniques de chasse ne sont documentées que dans la mesure où elles ont servi de thèmes d'inspirations aux artistes. Aussi le thème qui nous intéresse n'est-il pas particulièrement développé dans les collections. (une salle d'armes, une salle de trophées, et une salle d'art) ouvert en 1967 dans immeuble construit par Mansart et on peut y voir les tableaux des chiens d'arrêt (qui étaient familiers du roi, pas comme les chiens courants de meute) ...de Louis XIV !
x
x
x
 x au 2ème étage à gauche oui
sur ce plan on voit mal le coffret (au centre) qui contient l'essentiel du
service c'est quoi un service ? déjeuner royal des chasses , commandé en
1817 offert en 1819 par Louis XVIII à son neveu le duc de Berry , se compose
d'un plateau, 12 tasses une théière un sucrier un pot à lait décoré par
Robert peintre à la manufacture et peintre des tableaux des chasses du duc ,
une pièce = un type de chasse motifs géométriques symboles cynégétiques
dorés à l'or ou au platine par Jean-Claude Gérard chef des peintres de la
manufacture de Sèvres (lévieres, filets, cors dagues, ect sur fond bleu
marine) derrière les tasses
x au 2ème étage à gauche oui
sur ce plan on voit mal le coffret (au centre) qui contient l'essentiel du
service c'est quoi un service ? déjeuner royal des chasses , commandé en
1817 offert en 1819 par Louis XVIII à son neveu le duc de Berry , se compose
d'un plateau, 12 tasses une théière un sucrier un pot à lait décoré par
Robert peintre à la manufacture et peintre des tableaux des chasses du duc ,
une pièce = un type de chasse motifs géométriques symboles cynégétiques
dorés à l'or ou au platine par Jean-Claude Gérard chef des peintres de la
manufacture de Sèvres (lévieres, filets, cors dagues, ect sur fond bleu
marine) derrière les tasses
|
Le service complet, M.C.N., cliché personnel |
- une tasse en
porcelaine de Sèvres, peinte en 1817 par Jean-François Robert,
peintre des chasses du duc de Berry (n° d'inv. 66.20) on ne voit pas le furet,
c'est normal on
ne voit pas les numéro d'inventaire de toutes les pièces mais
normalement c'est cette tasse problème quand on n'a pas de numérique ce
jour-là et de toute façon compter avec la distance mise par l'imposante
vitrine qui ne permet pas bien de voir de près un objet au dessin si fin et minuscule,
à se demander s'il faudrait une loupe de toute façon pour couper court à
toutes polémique inutile, le catalogue du musée est clair !
on
ne voit pas les numéro d'inventaire de toutes les pièces mais
normalement c'est cette tasse problème quand on n'a pas de numérique ce
jour-là et de toute façon compter avec la distance mise par l'imposante
vitrine qui ne permet pas bien de voir de près un objet au dessin si fin et minuscule,
à se demander s'il faudrait une loupe de toute façon pour couper court à
toutes polémique inutile, le catalogue du musée est clair !
- une lithographie de V. Adam "Chasse au furet", (n° d'inv. 62.93.1) quand j'ai visité, la litho n'était pas exposée (les réserves sont au troisième étage) tiens ? eux aussi ? celle qui est au MIC de Gien est visible sur la première page d'Histoire de l'Art
x
x
|
La tasse au furetage, M.C.N., cliché personnel |
![]()
Et le seul musée en Europe spécialement consacré au braconnage !!! Depuis 1997, La Maison du Braconnage est un petit musée à Chaon (41600 Loir et Cher) encore en région Centre, décidément au centre de la culture du furetage ! Pour le moment je n'ai pas encore d'information là-bas sur la présence ou non d'éléments liés au furetage, affaire à suivre... Le nom du musée peut paraître provocateur, style "musée des crimes et délits", mais il s'agit plus (en pleine Sologne) de s'inscrire dans les musées de traditions régionales et certainement pas l'apologie du braconnage ! o)
![]()
![]() :
Vous n'êtes pas propriétaire de furet, vous n'en avez jamais vu
chez un ami, et vous ne fréquentez pas les animaleries : donc
vous n'en avez jamais vu " grandeur nature " ? Allez
dans un muséum ! Ca a été très laborieux pour avoir cette image, mais c'est
un autre problème, et je veux bien comprendre qu'il y a des priorités dans la
communication au public. Les plus gros muséums d'Histoire Naturelle de Province ont dans
leur collection au moins un exemplaire de furet. Par la même occasion, c'est pour tous
ceux (comme moi) qui ne sont pas des naturalistes chevronnés de
voir et de comparer ses cousins sauvages : putois, vison,
hermine, belette, présents à côté. Sur la qualité
visuelle et esthétique, il peut y avoir des différences
énormes selon la date où a été faite la naturalisation. Et indépendamment des problèmes de
conservation. Les spécimens du
XIX° Siècle constituent en effet une part considérable des
collections des muséums français, et la taxidermie comme la
communication muséologique ont fait des progrès considérables
ces dernières années ; vous n'avez qu'à voir la Grande Galerie
du muséum de Paris : vous n'avez même pas idée de ce que ça
peut donner (travail de la lumière, des sons, etc.) comme
spectacle.
:
Vous n'êtes pas propriétaire de furet, vous n'en avez jamais vu
chez un ami, et vous ne fréquentez pas les animaleries : donc
vous n'en avez jamais vu " grandeur nature " ? Allez
dans un muséum ! Ca a été très laborieux pour avoir cette image, mais c'est
un autre problème, et je veux bien comprendre qu'il y a des priorités dans la
communication au public. Les plus gros muséums d'Histoire Naturelle de Province ont dans
leur collection au moins un exemplaire de furet. Par la même occasion, c'est pour tous
ceux (comme moi) qui ne sont pas des naturalistes chevronnés de
voir et de comparer ses cousins sauvages : putois, vison,
hermine, belette, présents à côté. Sur la qualité
visuelle et esthétique, il peut y avoir des différences
énormes selon la date où a été faite la naturalisation. Et indépendamment des problèmes de
conservation. Les spécimens du
XIX° Siècle constituent en effet une part considérable des
collections des muséums français, et la taxidermie comme la
communication muséologique ont fait des progrès considérables
ces dernières années ; vous n'avez qu'à voir la Grande Galerie
du muséum de Paris : vous n'avez même pas idée de ce que ça
peut donner (travail de la lumière, des sons, etc.) comme
spectacle.
Peut-on dater l'époque d'un spécimen, même grossièrement, sans avoir la fiche d'inventaire ? En Taxidermie, il existe une évolution technique et une évolution stylistique assez marquée. Techniquement (pour les mammifères) on faisait autrefois une armature rigide (souvent en bois) avec un bourrage en paille (d'où le terme "d'animaux empaillés"), et ce jusque dans la deuxième moitié du XX° Siècle. Ensuite vient la manière actuelle où l'on fait une sculpture de la forme, en polystyrène ou en polyurétane. Ce n'est donc pas tellement au niveau de la peau que ça a évolué. Stylistiquement, on peut voir aussi une évolution des début de cet activité (XVIII° Siècle) à nos jours. Jadis, on représentait les animaux dans des poses très conventionnelles, un peu comme des statues type ; aujourd'hui les postures sont plus variées, dans le sens de scènes de la vie animale. Justement, la mise en scène et l'accompagnement pédagogique ont aussi connu une montée en puissance parallèle, depuis les simples étiquettes originelles. En Province, la présentation reste encore souvent très traditionnelle (et sent bien le formol agressif), faute de moyens...
C'est par exemple le cas à Bordeaux, dont le M.H.N. possède un exemplaire putoisé dans la grande salle consacrée à la faune générale (2° étage) à droite, sur un même plan visuel que les mustélidés sauvages ; le premier étage (collections régionales) présente aussi des mustélidés sauvages, dont beaucoup d'hermines. Le furet est d'ailleurs un des très rares animaux domestiques présents au Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux (il paraît que "ça ne se fait plus ", comme toute la collection de chiens descendue de la galerie supérieure aux réserves o). Vu sa taille, c'est un mâle ; par contre deux choses peuvent surprendre. Outre la robe (qui n'est pas du standard le plus courant aujourd'hui), le cou est puissant et épais : ça fait un peu furet gras ; bon, on va mettre ça sur le compte d'une exagération taxidermique de l'époque. A défaut d'avoir eu la fiche d'inventaire, l'étiquette mentionne seulement l'espèce et le sexe de l'animal photographié ici ; il n'y a pas d'indication sur l'origine géographique du spécimen (qui pour nos espèces locales venaient souvent de Gironde et des Charentes). L'âge ancien de l'étiquette est contemporain de la plupart des autres, et rien ne s'oppose à dater ce furet de muséum de l'essentiel du reste des collections, à savoir du XIX° Siècle au début du XX° (en faisant large, on ne risque pas se tromper o) !). Notre bébête empaillée est présentée la gueule fermée, ce qui ajoute au contraste avec ses voisins sauvages, conventionnellement représentés gueule ouverte... et pas toujours en bon état.
 |
| Furet naturalisé, Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux |
Le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris est l'un des plus gros du monde : bien sûr, on peut y trouver des exemplaires de furet (Mustela furo). Il y en a même plusieurs dans les collections, sous forme de peaux ou de squelettes -montés ou pas ; ça ne veut pas dire que vous le verrez exposé, vu l'importance des réserves (avec la fameuse Zoothèque). Vous n'en verrez pas dans la célèbre Grande Galerie (galerie de l'évolution) même au deuxième étage, où est traitée la domestication. Rien de scandaleux à cela : il faut être honnête, le furet n'occupe pas une place aussi importante dans l'histoire de l'homme que le chien ou le boeuf... Et de toute façon la politique actuelle des muséums est à la présentation de thématiques aérées qu'aux entassements d'un maximum d'espèces existantes sur terre. Des spécimen sinon célèbres mais au moins publiés de furets du Muséum, on retiendra au moins l'exemplaire -squelette- consulté par J.-B. Panouse pour sa publication de 1957 (référence C.G. 1905 n° 616 bis) et reproduit dans la figure 56 de son ouvrage ; ce furet de la III° République venait de la Ménagerie du muséum, comme quoi il n'y avait pas là-bas que des bêtes très exotiques o) !
![]()
![]() :
De toutes les catégories de documents iconographiques
que vous trouverez sur le site, l'héraldique est certainement la
plus ésotérique ! L'héraldique (science des armoiries)
européenne est née dans un cadre civilisationnel très
différent de notre société actuelle ; ça se ressent très
nettement sur le langage employé... En gros ce qu'il faut
comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un élément décoratif
où l'on recherche à produire une image la plus artistique possible, mais d'un code. C'est le même principe que les
panneaux de signalisation actuels -et d'ailleurs c'était fait
pour être vu de loin ; d'où une nécessaire stylisation. Il y a d'abord un écu -espace qui peut être de
forme différente. Ensuite des couleurs : il n'en existe que six,
dont on ne tien pas compte de la nuance ; leur appellation
héraldique est très particulière : le blanc se dit
"argent", le noir "sable", le rouge
"gueules", le bleu "azur", le jaune
"or", et le vert "sinople". Attention, il y a
des règles précises dans l'assemblage et la superposition des
couleurs ! Ensuite il y a les figures du blason, qui sont elles
illimitées. Il y a plusieurs plans et façons de compartimenter
un écu : l'ordre de lecture se fait du plan du fond vers le plan
rapproché. dans les figures, il existe d'ailleurs deux
"fourrures" : le vair et l'hermine (blanc moucheté
comme dans le drapeau breton). Dans ces compartiments, figurent
aussi les "meubles" : objets, végétaux, animaux,
éléments naturels, etc. Là aussi, peut importe le style ou la
manière dont il sont représentés : c'est "l'idée
de" dont il faut tenir compte, c'est un code de signes. Sur
le sens d'un blason, très souvent il est méconnu. En général,
il peut s'agir d'un lien avec l'activité, le lieu ou l'histoire
de la personne concernée, ou d'une légende parlante (comme un
rébus, quoi).
:
De toutes les catégories de documents iconographiques
que vous trouverez sur le site, l'héraldique est certainement la
plus ésotérique ! L'héraldique (science des armoiries)
européenne est née dans un cadre civilisationnel très
différent de notre société actuelle ; ça se ressent très
nettement sur le langage employé... En gros ce qu'il faut
comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un élément décoratif
où l'on recherche à produire une image la plus artistique possible, mais d'un code. C'est le même principe que les
panneaux de signalisation actuels -et d'ailleurs c'était fait
pour être vu de loin ; d'où une nécessaire stylisation. Il y a d'abord un écu -espace qui peut être de
forme différente. Ensuite des couleurs : il n'en existe que six,
dont on ne tien pas compte de la nuance ; leur appellation
héraldique est très particulière : le blanc se dit
"argent", le noir "sable", le rouge
"gueules", le bleu "azur", le jaune
"or", et le vert "sinople". Attention, il y a
des règles précises dans l'assemblage et la superposition des
couleurs ! Ensuite il y a les figures du blason, qui sont elles
illimitées. Il y a plusieurs plans et façons de compartimenter
un écu : l'ordre de lecture se fait du plan du fond vers le plan
rapproché. dans les figures, il existe d'ailleurs deux
"fourrures" : le vair et l'hermine (blanc moucheté
comme dans le drapeau breton). Dans ces compartiments, figurent
aussi les "meubles" : objets, végétaux, animaux,
éléments naturels, etc. Là aussi, peut importe le style ou la
manière dont il sont représentés : c'est "l'idée
de" dont il faut tenir compte, c'est un code de signes. Sur
le sens d'un blason, très souvent il est méconnu. En général,
il peut s'agir d'un lien avec l'activité, le lieu ou l'histoire
de la personne concernée, ou d'une légende parlante (comme un
rébus, quoi).
![]() : Au départ,
il n'était pas du tout sûr de trouver mention du furet en
héraldique. Encore une fois grâce à Gallica (ouvrages
numérisés de la BNF en ligne), on peut trouver des perles ; par
exemple le dictionnaire de o'Kelly, une véritable somme sur le
blason : Dictionnaire Archéologique et Explicatif de la
Science du Blason, Alphonse-Charles O'Kelly de Galway,
Imprimerie Générale du Sud-ouest, 1901. Chaque fois on me
demande : c'est un auteur français ? Oui, il fait partie de la
noblesse irlandaise émigrée en France après les persécutions
anglaises du XVII° s. Voilà ; il existe un article furet p.280
: " Furet : Originaire des pays chauds,
il ne peut subsister sous notre zone que comme animal domestique.
On se sert du furet, dont la fourrure est d'un blanc jaunâtre,
pour la chasse au lapin sauvage. Il a les yeux d'un rouge rosé
et s'apprivoise aisément.
: Au départ,
il n'était pas du tout sûr de trouver mention du furet en
héraldique. Encore une fois grâce à Gallica (ouvrages
numérisés de la BNF en ligne), on peut trouver des perles ; par
exemple le dictionnaire de o'Kelly, une véritable somme sur le
blason : Dictionnaire Archéologique et Explicatif de la
Science du Blason, Alphonse-Charles O'Kelly de Galway,
Imprimerie Générale du Sud-ouest, 1901. Chaque fois on me
demande : c'est un auteur français ? Oui, il fait partie de la
noblesse irlandaise émigrée en France après les persécutions
anglaises du XVII° s. Voilà ; il existe un article furet p.280
: " Furet : Originaire des pays chauds,
il ne peut subsister sous notre zone que comme animal domestique.
On se sert du furet, dont la fourrure est d'un blanc jaunâtre,
pour la chasse au lapin sauvage. Il a les yeux d'un rouge rosé
et s'apprivoise aisément.
Cet animal est le symbole d'un homme qui aime à chercher et à trouver ce qui lui convient. On le voit dans les blasons de quelques gentilshommes verriers de Lorraine et de Champagne. " Voilà le sens du furet en héraldique : c'est à l'image du comportement de notre animal explorateur : curieux et obstiné ! On voit aussi sa rareté...
Pour pouvoir poursuivre cette piste, il faudrait avoir accès aux armoriaux (livre l'armoiries) de ces régions. Et c'est précisément le type de livres à accès restreint... affaire à suivre. Par les armoriaux généraux, il a été possible de retrouver quatre références de blasons au furet... contre 7 pour la fouine, 14 pour l'hermine (comme meuble), et une quinzaine pour la belette ! Telle qu'elle est dessinée dans les armoriaux, l'hermine ressemble assez au furet si ce n'est sa fameuse queue à pointe noire (vous pouvez en voir dans l'Encyclopédie de d'Alembert et Diderot, pl. XII, fig. 618). L'une ne figure pas sur le site, c'est le blason de la famille Beyen, où le furet ne figure qu'en arme non complète (coupé). Les exemples retrouvés :
 |
| Blason de la famille Bigault de Casanove |
" D'azur à trois furets rampants d'argent, les deux en chef adossés, accompagnés de trois étoiles mal-ordonnées d'or." La référence vient d'un ouvrage belge : Dictionnaire des Figures Héraldiques, Comte Théodore de Renvere, Société Belge de Librairie, 1897. L'auteur faisait autorité sans problème, membre de la Société Royale de Généalogie, et dont le travail s'étend au delà de la Belgique. Vous avez là la figure 5 de la planche XIII... colorisée avec les moyens du bord sous Paint.
![]()
 |
| Blason de la famille De Bigault d'Avocourt |
" D'azur à trois furets d'argent, les deux en chef adossés, accompagnés de trois étoiles du mesme, deux en flancs et un en pointe. " Les De Bigault d'Avoncour, comme leurs branche De Parfourut et De Grandrut, sont de petite noblesse du centre de la France (Berry, Clermontois) et étés à plusieurs époques chevaux-légers de la Garde du Roi. Là les informations viennent du Grand Armorial de France, d'Henri Jouglas de Morenas, éd. Les Héraldiques, 1934 ; en réalité c'est une réédition complétée : l'édition originale date de Louis XIV (1696), c'est un monument du genre. Par rapport à la première famille, on voit beaucoup d'éléments communs, mais dans une association différente.
![]()
 |
| Blason de la famille Furet de Prébaron |
" D'azur à une bande d'or chargée d'un furet courant de sable. " Là, c'est dans l'association des couleurs que l'on voit des points communs. Un furet noir, ça paraît curieux mais il n'est pas permis par les règles de l'héraldique (et du bon sens parce que cela ne ce voit pas) de mettre du blanc sur du jaune. Et la couleur d'un "meuble" par rapport à l'animal vrai importe peu : un cheval peut théoriquement être rouge ou un aigle bleu... On a là un exemple d'arme parlante : la famille s'appelle Furet de Prébaron et a un furet sur son écu. Il s'agit d'une famille de petite noblesse de Franche-Comté, où l'héraldique s'est développée dans un contexte différent du royaume de France (Bourgogne et Saint-empire).
![]()
![]() Pour le furet dans
monnaie, les éléments ne sont pas légion. En monnaie
contemporaine on ne trouve a priori qu'un seul exemple
dans le Standard Catalog of World Coin Atlas, la bible des
monnaies contemporaines (toutes les monnaies de tous les pays
depuis deux siècles). Il s'agit de la pièce de 1 Cent de la
République de Malte ; cette série a commencé en 1986
(deuxième série de la décimalisation). Descriptif : métal,
copper-nickel ; poids, 2,81g ; diamètre : 18,51mm. En
numismatique contemporaine - à priori portée vers le
réalisme-, les contraintes matérielles (taille des petites
divisions) imposent toujours une bonne part de stylisation.
Pour le furet dans
monnaie, les éléments ne sont pas légion. En monnaie
contemporaine on ne trouve a priori qu'un seul exemple
dans le Standard Catalog of World Coin Atlas, la bible des
monnaies contemporaines (toutes les monnaies de tous les pays
depuis deux siècles). Il s'agit de la pièce de 1 Cent de la
République de Malte ; cette série a commencé en 1986
(deuxième série de la décimalisation). Descriptif : métal,
copper-nickel ; poids, 2,81g ; diamètre : 18,51mm. En
numismatique contemporaine - à priori portée vers le
réalisme-, les contraintes matérielles (taille des petites
divisions) imposent toujours une bonne part de stylisation.
 |
| Monnaie de 1 cent, Malte, 1986 |
Le catalogue la mentionnait comme figurant une belette "weassel" ; hors, une belette n'a ni une tête aussi allongée, ni une queue aussi fournie. Mais les différences entre les variétés de belettes peuvent aussi être importantes. La WFUIC penchait pour une interprétation "furet". Le mieux étant de demander à la source, un courrier à la Banque Centrale de Malte a finalement tranché le débat : les maltais ont voulu représenter la "Ballotra", variété locale de la belette. Pas de doute : il est bien précisé dans la légende de planche "animal de la faune de l'île nocturne et se nourrissant de petits animaux". Comme quoi dans les erreurs d'interprétation du "furet oublié", on peut vite tomber dans l'excès inverse et en voir partout ! Prudence ! Du côté monnaies anciennes, il y aurait peut-être à creuser dans la Numismatique Grecque (ancienne), mais c'est vraiment douteux. Par contre, la numismatique c'est aussi les jetons et les médailles ; et là tout espoir est permis ! Affaire à suivre...
![]()
![]() : Là, je m'attendais à trouver des images... et rien pour le
moment. Je suis prêt à parier qu'il existe quelque part des
timbres au furet, le problème c'est la recherche. Surtout dans
la deuxième moitié du XX° Siècle, il y a eu une véritable
explosion de la production de timbres. Imaginez tout ce qui se
produit chaque année, dans chaque pays sur tout sujet, c'est
considérable ! Justement, le problème est là : l'immensité de
la documentation et l'absence de vrai catalogage à la base
décourage visiblement toute composition de corpus exhaustif.
Même pour une recherche thématique animalière
! Il existerait en langue espagnole un catalogue thématique
animalier, connu des amateurs français, et une mystérieuse
Association Philatélique Thématique Française, dont je
n'arrive pas à trouver l'adresse ! Affaire à suivre...
: Là, je m'attendais à trouver des images... et rien pour le
moment. Je suis prêt à parier qu'il existe quelque part des
timbres au furet, le problème c'est la recherche. Surtout dans
la deuxième moitié du XX° Siècle, il y a eu une véritable
explosion de la production de timbres. Imaginez tout ce qui se
produit chaque année, dans chaque pays sur tout sujet, c'est
considérable ! Justement, le problème est là : l'immensité de
la documentation et l'absence de vrai catalogage à la base
décourage visiblement toute composition de corpus exhaustif.
Même pour une recherche thématique animalière
! Il existerait en langue espagnole un catalogue thématique
animalier, connu des amateurs français, et une mystérieuse
Association Philatélique Thématique Française, dont je
n'arrive pas à trouver l'adresse ! Affaire à suivre...
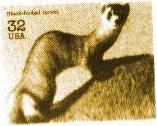 |
| Timbre de 32 cent, USA, 1996 ; 2548, dentelé 11 |
Il est bizarre, ce furet ? Ben oui c'est normal, ce n'est pas un furet (Mustela furo) mais un " Furet pieds-noirs " (Mustela nigripes), animal américain du groupe des "putois" bien éloigné du furet... pas mieux pour l'instant. dans la même voie des timbres qui ressemblent au furet mais qui n'en sont pas, Lorraine Tremblay du site Mustela Francia m'a signalé l'existence d'un timbre belge au putois européen (Mustela putorius). Quand j'aurai accès à des outils récents et exhaustifs, on en reparlera. Désolé.
![]()
![]() : En
attendant, je donne dans la cartophilie (étude et collection des
cartes), qui est d'un très grand intérêt historique. Après
l'invention et la diffusion de la photographie, les cartes
postales ont été un vrai terrain de prédilection pour
cette invention ; notamment en France, les productions locales
sont vite devenues considérables dans la première moitié du
XX° Siècle. Cela nous permet d'avoir des photographies de
qualité sur des endroits ou des activités précis et
identifiés de l'époque. c'est très important en histoire
locale, pour avoir une idée du visage et de l'évolution d'une
commune en complément des données cartographiques. Au recto ou
au verso, une carte poste comporte un titre (avec mention de
lieu) et une mention d'édition (avec ou non le nom de
photographe, selon date ou lieu). Bref, un document
immédiatement identifiable et localisable. le seul problème,
c'est la recherche des cartes ; pas de catalogue exhaustif
évidement. Une recherche thématique reste aléatoire. Cette
carte (collection Muguette Rigaud) est par exemple issue d'un
livre sur le braconnage : Le livre du braconnier, Marieke
et Pierre Aucante, 1990.
: En
attendant, je donne dans la cartophilie (étude et collection des
cartes), qui est d'un très grand intérêt historique. Après
l'invention et la diffusion de la photographie, les cartes
postales ont été un vrai terrain de prédilection pour
cette invention ; notamment en France, les productions locales
sont vite devenues considérables dans la première moitié du
XX° Siècle. Cela nous permet d'avoir des photographies de
qualité sur des endroits ou des activités précis et
identifiés de l'époque. c'est très important en histoire
locale, pour avoir une idée du visage et de l'évolution d'une
commune en complément des données cartographiques. Au recto ou
au verso, une carte poste comporte un titre (avec mention de
lieu) et une mention d'édition (avec ou non le nom de
photographe, selon date ou lieu). Bref, un document
immédiatement identifiable et localisable. le seul problème,
c'est la recherche des cartes ; pas de catalogue exhaustif
évidement. Une recherche thématique reste aléatoire. Cette
carte (collection Muguette Rigaud) est par exemple issue d'un
livre sur le braconnage : Le livre du braconnier, Marieke
et Pierre Aucante, 1990.
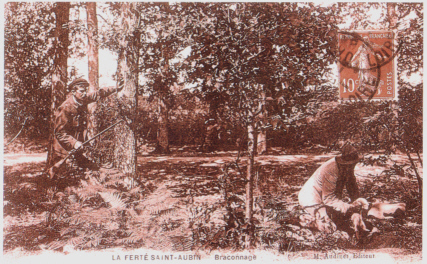
La Ferté St-Aubin, c'est où ? En Sologne, dans le département du Loiret près d'Orléans. Ce qui est frappant dans la zone de furetage, c'est son caractère dégagé : quelques fougères, pas de vraie broussaille, et il y a même un chemin large au second plan. Comment peut-il exister une carte postale de braconnage ? Ca veut dire éditer une preuve de délit ! Évidement, ce n'est pas une photo de flagrant délit, mais des habitants qui ont "posé pour" ; pour les cartes de vie quotidienne, les photographes ne prenaient souvent pas sur le vif (comme pour les photos de lieux) mais demandaient de refaire les gestes à l'identique pour avoir une image exploitable. Donc même artificielle, la photo est quand même historiquement fiable. Le dispositif n'est pas celui de la chasse au filet, mais au fusil : il suppose d'être à plusieurs pour tirer le lapin qui jaillit à la sortie du terrier, épouvanté par le furet. Le fufu est très bien visible, c'est un putoisé de bonne taille ; un agrandissement n'apporterait rien, même pour déterminer le sexe. Le grand intérêt "furet" de l'image, c'est de voir un mode d'introduction du furet, rare en iconographie : l'introduction verticale dans le terrier. Jusque-là, tous les documents iconographiques que vous aviez pu voir montraient une introduction horizontale, sans exception.
![]()
 ).
).
Deuxième exemple avec cette carte postale d'Avant-guerre, entre 1900 et 1915 (d'après les uniformes, on voit même un zouave au 2° rang au dessus du chien o), le personnel de l'Hôpital Militaire n°9 de Champrosay (Seine-et-Oise) ; elle est intitulée " Chasse aux lapins " Maule, ed. Fageot , avec 350 autres dans L'âge d'or de la chasse par les cartes postales, de J.-J. Renaud (chez Ramsay, en 1987). D'une chasse au furet en loisir légal cette fois-ci, pour améliorer un ordinaire militaire... en lapin. Evidemnt je me suis demandé où était Champrosay o). Pour les franciliens, le département de la Seine-et-Oise était l'ancien département qui faisait à l'Ouest pendant à la Seine-et-Marne avec Essonne, Yvelines et Val-d'Oise (le département de la Seine faisant alors Paris et la petite couronne). Aujourd'hui Champrosay est un lieu-dit de la commune de Draveil près d'Evry (91). Entre-temps la Première Guerre Mondiale est passée et l'H.M.9 s'appelle maintenant l'Hôpital Joffre. Il se trouve à la lisière de la forêt de Sénart, d'où explication de la photo... Vous allez me dire " il est où le furet ? " Partez du centre du groupe, et allez vers la droite : vous le verrez près du sol. C'est là aussi un putoisé.

Effectivement, le furet est petit sur la photo et ça justifiait un gros plan ! Mais l'intérêt de la photo n'est pas que de voir un furet de l'époque du Titanic (un putoisé en l'occurrence). On voit bien la manipulation du furet, avec la main là où c'est important pour ne pas gigoter pendant la photo (le fait est que là il a l'air de regarder vers le chien). Mais les centres d'intérêt de la photo sont tout autant sur les côtés du furet, puisque les militaires ont "posé" pour le photographe en exposant la plupart des éléments de de la chasse au lapin ! De gauche à droite on a : le sac, le chien, le lapin (c'est là que commence le gros plan), le filet (ou bourses), notre putoisé, la boîte à furet, le trou (ou gueule), et enfin le bâton... On voit là les options les plus économiques : pas de muselière et pas de sac de cuir pour le transport.
![]()
D'autres images ? pour le moment vous en avez déjà une autre sur le très bon site de Régys " Le passé composé ", où la photo sent bien la pose : on y voit un garde-chasse (reconnaissable à sa plaque ovale en bandouillère) poser avec tout un attirail de saisie de braconnage, pièges à mâchoires et j'en passe... et un furet albinos (probablement une femelle vu sa taille modeste).
![]()
Une fois encore, c'est un monde esthétique complet à explorer. Et en plus, il se renouvelle très vite ! Je suis très classique dans mes goûts BD, et il aurait certainement des images à "gratter ". Si vous avez vu des apparitions du furet en BD, n'hésitez pas à m'envoyer un mèl. Voilà en attendant, deux séries francophones ont été recensées (clin d'œil à Laetitia) où des furets tiennent des rôles principaux ; le moins que l'on puisse dire c'est que dans la B.D. francophone les furets n'ont pas souvent le beau rôle...
![]() " Les
lumières de l'Amalou ". A vrai dire on est dans le genre
fantastique, et le peuple des furets dans la
" Les
lumières de l'Amalou ". A vrai dire on est dans le genre
fantastique, et le peuple des furets dans la série est très anthropomorphe. Un monde surréaliste à base de décor
désuets très Avant-guerre, où se côtoient et s'affrontent les
Furets et les Transparents. Il y a aussi des Gouals, des Humains,
des Cafous, des Bigops des Hybrides, et quand même les furets "à l'état
natifs" animal que nous connaissons. Venus de Frouzéville, les deux héros -furets
anthropomorphisés comme les autres- Elwood le bedonnant serviteur et Andréa l'élégant
aristocrate ont
atterris en catastrophe sur les rives du fleuve Amalou... et
l'histoire commence. Des lieux étranges où plane un mystère
permanent. Pour vous donner une idée, le scénariste est le
même que celui de Terres d'ombres. Les références : Les
lumières de l'Amalou, C. Gibelin (scen.) et C. Wendling
(ill.), collection Conquistador, éditions Delcourt. (T. 1 : ISBN
2-906187-53-4). Série française, de cinq tomes débutés en 1990. Prix du
meilleur jeune illustrateur (rice en l'occurrence) au
Festival national de la Bande Dessinée d'Angoulême 1992. Cinq ans plus tard,
la série a connu l'honneur d'être rééditée en grand album d'édition
complète (ISBN 2-84055-154-3).
série est très anthropomorphe. Un monde surréaliste à base de décor
désuets très Avant-guerre, où se côtoient et s'affrontent les
Furets et les Transparents. Il y a aussi des Gouals, des Humains,
des Cafous, des Bigops des Hybrides, et quand même les furets "à l'état
natifs" animal que nous connaissons. Venus de Frouzéville, les deux héros -furets
anthropomorphisés comme les autres- Elwood le bedonnant serviteur et Andréa l'élégant
aristocrate ont
atterris en catastrophe sur les rives du fleuve Amalou... et
l'histoire commence. Des lieux étranges où plane un mystère
permanent. Pour vous donner une idée, le scénariste est le
même que celui de Terres d'ombres. Les références : Les
lumières de l'Amalou, C. Gibelin (scen.) et C. Wendling
(ill.), collection Conquistador, éditions Delcourt. (T. 1 : ISBN
2-906187-53-4). Série française, de cinq tomes débutés en 1990. Prix du
meilleur jeune illustrateur (rice en l'occurrence) au
Festival national de la Bande Dessinée d'Angoulême 1992. Cinq ans plus tard,
la série a connu l'honneur d'être rééditée en grand album d'édition
complète (ISBN 2-84055-154-3).
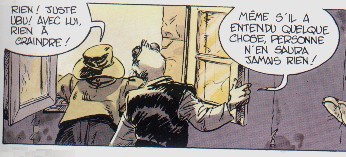 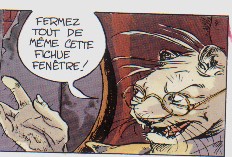 |
| Les lumières de l'Amalou, t.1 " Théo ", p. 9, 1990 |
Je dirais juste que cette scène a lieu sur l'Île... J'aurai pu prendre une excellente illustration du t.3, mais cela aurait gâché le suspens. D'ailleurs ne comptez pas sur moi pour dire qui est Théo, comment les deux héros se retrouvent sur sa piste, et pourquoi, et que sais-je encore ? o)
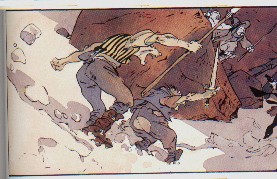 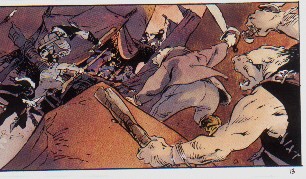 |
| Les lumières de l'Amalou, t.5 " Cendres ", p. 15, 1996 |
Comme l'histoire est en continu sur les cinq album, je ne peux pas pousser trop loin le commentaire des images sélectionnées ; ces deux-là viennent du Royaume de l'Arbre. A vous de la découvrir ; une BD peu banale en tout cas...
|
| Les lumières de l'Amalou, t.5 " Cendres ", p. 27, 1996 |
![]()
![]() "
Martine ", aux éditions Casterman : ne connaissant pas la série,
j'ai eu ce tuyau grâce à la webmestre
du site Truffe et Mirabelle. Le furet figure dans deux
albums de la série. Bande dessinée ou pas ? Il s'agit en réalité de "
livre jeunesse ", pour apprendre la lecture aux tout-petits (fin de
maternelle ou C.P. selon les cas) ; mais bon, je ne vais pas créer 36000
catégories et sous-catégories de documents, certains internautes (et pas des
moins doués) ayant déjà du mal à se repérer sur le site... Le principe,
c'est que sur une page (petit format) se trouve sans cadre plusieurs grosses
images et lignes de texte écrit gros (donc pas de bulles), avec une technique
de fondu. Martine est en réalité une série très connue : débutée en 1953,
elle a passé le millénaire (avec les évolutions stylistiques qui vont avec),
la série des aventures comprend une cinquantaine albums (plus de 45 millions
d'exemplaires vendus), auquel il faut rajouter des albums dérivés et beaucoup
de produits dérivés (parascolaires ou ludiques). Le succès de la série passe
pour venir de la variété des thèmes (Martine fait même de la mongolfière o)
et de la qualités des illustrations, belles, réalistes et détaillées. Sa
création est belge, il s'agit du tandem Marcel Marlier le dessinateur (qui a
aussi illustré des livres scolaires et des contes) et Gilbert Delahaye le
scénariste mort en 1997 (avec un prix littéraire en 1985). Qui est martine ?
Une fillette, personnage d'une
jeune fille positive, qui permet l'identification de la lectrice(eur) ; ce qui
ne l'empêche pas de faire des erreurs ou petites bêtises, mais aux antipodes
des enfants barbares qu'on voit parfois lâchés aujourd'hui. On pourrait la
qualifier de dynamique, voyageuse, sportive, amie de la nature, sociable,
joyeuse, et surtout curieuse : le caractère d'éveil est la clé de la série.
Série-phare de la littérature jeunesse, Martine a fait l'objet de plusieurs
études : en 2001, vous avez par exemple en ligne le résumé
d'un mémoire en
Sciences de l'Information et de la Documentation à l'Université de Lille III.
Certains se sont interrogés sur le caractère " lisse " de la série
et si elle préparait bien les enfants au monde d'aujourd'hui ; mais bon à cet
âge là, il leur sera toujours temps plus tard de découvrir à l'âge de
raison Al-Qaida, les
serial-killers, et les professionnels de l'immobilier...
"
Martine ", aux éditions Casterman : ne connaissant pas la série,
j'ai eu ce tuyau grâce à la webmestre
du site Truffe et Mirabelle. Le furet figure dans deux
albums de la série. Bande dessinée ou pas ? Il s'agit en réalité de "
livre jeunesse ", pour apprendre la lecture aux tout-petits (fin de
maternelle ou C.P. selon les cas) ; mais bon, je ne vais pas créer 36000
catégories et sous-catégories de documents, certains internautes (et pas des
moins doués) ayant déjà du mal à se repérer sur le site... Le principe,
c'est que sur une page (petit format) se trouve sans cadre plusieurs grosses
images et lignes de texte écrit gros (donc pas de bulles), avec une technique
de fondu. Martine est en réalité une série très connue : débutée en 1953,
elle a passé le millénaire (avec les évolutions stylistiques qui vont avec),
la série des aventures comprend une cinquantaine albums (plus de 45 millions
d'exemplaires vendus), auquel il faut rajouter des albums dérivés et beaucoup
de produits dérivés (parascolaires ou ludiques). Le succès de la série passe
pour venir de la variété des thèmes (Martine fait même de la mongolfière o)
et de la qualités des illustrations, belles, réalistes et détaillées. Sa
création est belge, il s'agit du tandem Marcel Marlier le dessinateur (qui a
aussi illustré des livres scolaires et des contes) et Gilbert Delahaye le
scénariste mort en 1997 (avec un prix littéraire en 1985). Qui est martine ?
Une fillette, personnage d'une
jeune fille positive, qui permet l'identification de la lectrice(eur) ; ce qui
ne l'empêche pas de faire des erreurs ou petites bêtises, mais aux antipodes
des enfants barbares qu'on voit parfois lâchés aujourd'hui. On pourrait la
qualifier de dynamique, voyageuse, sportive, amie de la nature, sociable,
joyeuse, et surtout curieuse : le caractère d'éveil est la clé de la série.
Série-phare de la littérature jeunesse, Martine a fait l'objet de plusieurs
études : en 2001, vous avez par exemple en ligne le résumé
d'un mémoire en
Sciences de l'Information et de la Documentation à l'Université de Lille III.
Certains se sont interrogés sur le caractère " lisse " de la série
et si elle préparait bien les enfants au monde d'aujourd'hui ; mais bon à cet
âge là, il leur sera toujours temps plus tard de découvrir à l'âge de
raison Al-Qaida, les
serial-killers, et les professionnels de l'immobilier...
|
|
Martine, " Il court il court le furet ", p.14 , 1995 |
Martine, il court il court le furet en 1995 (ISBN 2-203-10145-8) est l'album de Martine où le furet tient le rôle central, sur 24 pages (collection Farandole). L'album est classé dans les livres d'apprentissage, à partir de 3 ans, mais son intérêt reste tout même pour plus tard pour apprendre à lire. Au delà des qualités générales de la série, le livre est très intéressant, pédagogique et valorisant pour le furet. Mi-furet de travail, mi-furet de compagnie, l'animal montré est " le furet typique ", un albinos. Pour dévoiler un peu l'histoire, Martine va chez ses grands-parents ; et un matin, l'horreur !!! Les fleurs du jardin sont saccagées, le merveilleux potager pillé ; un soir, les coupables sont découverts : des %@$£µ§! de @aloperie de lapins (enfin c'est pas dit comme ça dans l'histoire) ! Le grand-père ne les gaze pas, pas d'arsenic, ni de lance-flamme ou de tronçonneuse non plus : heureusement un fermier voisin leur prête un furet, Finaud. Et non seulement il rempli bien son rôle (et proprement, sans leur crever un oeil ou arracher une oreille) mais il va aussi protéger Martine des souris, et elle va pouvoir le garder un peu pour jouer avec et le promener avec même le problème du ferret-proof. C'est un bon fufu, ça. Côté graphique le furet est très bien rendu, on a l'impression qu'il sourit tout le temps tellement il a une bonne bouille !
|
|
Martine, " Il court il court le furet ", couv. , 1995 |
Les amis de Martine et les animaux en 2000 (ISBN 2-203-10641-7) est le deuxième album où l'on peut voir un furet, et pour cause puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un remix thématique de sa collection d'aventures. Il fait 16 pages (collection Les amis de Martine) avec un but bien précis : apprendre pour l'enfant à associer mots et images ; en pointant une gommette où il faut, l'enfant peut compléter le texte et suivre l'histoire. Apprendre à lire donc, le livre est classé pour lecteurs débutants, à partir de 6 ans. Quand à ce qu'il y est dit dedans, je suis content de voir que je ne suis pas le seul à qui la tête du furet fait penser à un ourson... Et je reste persuadé que ça joue un rôle inconscient dans l'impulsion d'achat du furet de compagnie : j'aimerais bien que des spécialistes de la psychologie de la consommation se penchent là dessus.
|
|
Martine, " Les amis de Martine et les animaux", p.f, 2000 |
![]()
![]() " Sibylline et le
Kulgude " de R. Macherot, est parue aux éditions Dupuis en 1985
" Sibylline et le
Kulgude " de R. Macherot, est parue aux éditions Dupuis en 1985  (ISBN 2-8001-1137-2)
: j'ai eu cette référence très méconnue grâce à Laetitia du C.F.A.F. C'est
l'une des dernières histoires de cette série de 12 albums. Sibylline, c'est
d'abord de la B.D. belge, à la façon de l'école "du
Journal de Spirou" (tous les auteurs comme Franquin, Roba, Peyot) ; pour
simplifier, des graphismes enfantins du type " Schtroumfs ", aux
dessins très ronds et colorés. Son auteur (Raymond Macherot) s'est aujourd'hui
retiré de la bande dessinée, qu'il avait intégré en 1953. Il a d'abord
travaillé au Journal de Tintin (où il va innover en introduisant une
série animalière avec la souris Cholorophyle), avant d'enter au Journal de
Spirou pour plusieurs séries dont Sibylline et d'éhémères associations
avec Goscinny ou Franquin. La spécificité de R. Macherot, c'est de pouvoir
peindre avec de gentils personnages champêtres des situations sociales
dramatiques... C'est par exemple le cas avec la série Sibylline de 1965 à 1990
dans le journal (de 1967 à 1985 en album) ; pour l'album qui nous concerne
c'était de 1983 (journal n° 2332-2336) à 1984 (n° 2350-2355), avec
album en 1985. il a existé aussi un éphémère Sibylline
magazine ! Sur vingt
ans, ce personnage de souris débrouillarde et la série ont énormément
évolué, passant d'un gentil jeu du chat et la souris au début à un univers
magique peuplé aussi de personnages maléfiques.
(ISBN 2-8001-1137-2)
: j'ai eu cette référence très méconnue grâce à Laetitia du C.F.A.F. C'est
l'une des dernières histoires de cette série de 12 albums. Sibylline, c'est
d'abord de la B.D. belge, à la façon de l'école "du
Journal de Spirou" (tous les auteurs comme Franquin, Roba, Peyot) ; pour
simplifier, des graphismes enfantins du type " Schtroumfs ", aux
dessins très ronds et colorés. Son auteur (Raymond Macherot) s'est aujourd'hui
retiré de la bande dessinée, qu'il avait intégré en 1953. Il a d'abord
travaillé au Journal de Tintin (où il va innover en introduisant une
série animalière avec la souris Cholorophyle), avant d'enter au Journal de
Spirou pour plusieurs séries dont Sibylline et d'éhémères associations
avec Goscinny ou Franquin. La spécificité de R. Macherot, c'est de pouvoir
peindre avec de gentils personnages champêtres des situations sociales
dramatiques... C'est par exemple le cas avec la série Sibylline de 1965 à 1990
dans le journal (de 1967 à 1985 en album) ; pour l'album qui nous concerne
c'était de 1983 (journal n° 2332-2336) à 1984 (n° 2350-2355), avec
album en 1985. il a existé aussi un éphémère Sibylline
magazine ! Sur vingt
ans, ce personnage de souris débrouillarde et la série ont énormément
évolué, passant d'un gentil jeu du chat et la souris au début à un univers
magique peuplé aussi de personnages maléfiques.
Dans cette série le furet tient le rôle d'un des méchants personnages, le fameux Croque-monsieur, accompagné du rat Zakouski qui cherche toujours qui il va pouvoir manger dans "le bosquet joyeux", et se promène toujours avec un immense couteau ! C'est encore un furet anthropomorphisé, mais dans un style moins réaliste et plus enfantin par rapport à la série des Lumières de l'Amalou. Il a a de grandes canines et une longue queue, le dos noir, le ventre et la face jaune, des yeux cruels... Ni beau ni gentil, il n'a pas été fait pour être un calque d'un vrai furet. Et il est bien question de crimes sanglants, non masqués ; c'est ce qui gène et a limité le succès de la série : dessins trop enfantins pour les adultes, scénario trop cruel pour les enfants ?
|
|
Sybilline et le Kulgude, p.2, 1985 |
Outre notre furet de cauchemar et son acolyte, on voit sur cette image le corbeau Flouzemaker, un "animal d'affaire". Un vrai marchand de tapis qui arnaque ses clients (la monnaie du coin est la noisette). Dans cette histoire, il est pris dans la poésie de l'automne et fait une charmante rencontre... La grand-mère de cette jeune fille est censée être Zulma Zukorne, dont le simple nom fait fuir Zakouski (qui l'a attaqué 3 fois et s'est retrouvé trois fois dans le coma) ! Mais dans cette histoire sont aussi impliqués les sinistres Burokratz, Murmhur et le prince de Schnadsbol. Et depuis le début, vous vous demandez qu'est-ce que le Kulgude ? Un espèce de serpentin qui sort de terre pour indiquer où se trouve un trésor.
|
|
Sybilline et le Kulgude, p.37, 1985 |
Par rapport aux deux dernières images, tout avait commencé un beau matin de juin au lieu-dit Krobondjon (à l'Est de la lande de Gutaperka) ; Sibylline et son compagnon Tatoum étaient à la ruche du grand-père (six abeilles ! o) avec Flouzemaker. Et là, qu'apprend-t-on ? Zakouski rapporte à Croque-monsieur que Louella a un poison violent conte Zagabor ! Louella étant la prostituée venue de la ville (après avoir apprivoisé Flouzemaker au tour du violoneux), et Zagabor un héron jouant d'un violon magique capable de neutraliser Croque-monsieur. Cette perspective d'élimination réjouit notre furet sanguinaire ...si elle se réalise.
|
|
Sybilline et le Kulgude, p.31, 1985 |
![]()
Dans la BD de langue étrangère, on peut réussir à trouver des représentations du furet, et c'est ce qu'on fait les suédois du site Tammiller avec la BD américaine, casi-inconnue en France. Ils ont recensé les références directes et assimilées (" ressemblant à "). Ici, je ne citerai que les références directes au furet, identifié comme tel (pour le reste, allez sur leur site), à savoir deux séries. Epicurus the sage, vol. 2, W. Messener-Loebs et S. Keith. L'un des personnage de l'histoire, Semele, porte toujours avec lui un furet tout brun... Sluggy Freelance, il y a un furet qui s'appelle Kiki ! Il y a également sept livres de littérature SF et Fantastiques avec une figuration de furet : The last of the Winnebagoes, The swords of Lankhmar, Days of blood and fire, The last battlemege, Magician, The outcast of redwall. Et les mangas japonais, qui se vendent tellement en France ? Je crois que personne n'a encore cherché.
![]()
Voilà un terme qui a été souvent dévoyé, et ça ne va pas s'arranger avec ce chapitre ! Voilà quelques exemples à la rencontre des arts déco, de la joaillerie, et du commerce. On entendra ici le terme "art déco" au sens des arts décoratifs, pas du style des années vingt. Le champ est immense en tout cas : de l'horlogerie aux arts de la table, du mobilier au luminaire, on pourrait en faire une page pour les lister. Quand aux arts populaires, c'est vrai qu'ils renvoient au domaine des traditions et y inclut une dimension plus utilitaires (types objets ruraux de tous les jours). Voilà, comme ça tout le monde a les clés pour se repérer. Pour le moment, la recherche des utilisations du furet dans ce domaine plastique n'ont pas encore vraiment débuté (on ne peut pas tout faire à la fois, désolé!). Il est évident que pour le furet, on n'en est pas encore aux livres d'art et de collectionneurs comme pour les chats, chiens, tortues (ou même les lapins °), où l'on peut trouver de nombreux amateurs et des livres sur les petits bibelots de collection. En attendant, les images que vous verrez sont toutes des productions actuelles -en série ou pièces uniques- et sont visibles sur des sites commerciaux de designers, de boutiques sur le furet, ou même d'associations. Les références sont indiquées comme les liens vers les sites associatifs, mais je ne vous fait pas de liens ici vers les sites commerciaux (et la pub clandestine ?). Sur le furet comme ailleurs on peut trouver le pire et le meilleur dans les bibelots : tant qu'à faire, on essayera d'éviter les débats inutiles sur le mauvais ou non américain qui leur est souvent reproché ; parmi les meilleures productions visibles sur Internet, la palme revient peut-être aux réalisations d'une association allemande : le Frettchenclub de Berlin (cliquer dans le menu à droite sur " Fanartikel "). J'ai fait une présentation purement arbitraire par matières travaillées (alimentaires, bois, métaux, textile, verre), puis par mode de reproduction (infographie, sérigraphie, peinture), et enfin par type d'objet (décoratif, ludique, utilitaires). Il ne faut surtout pas voir dans ces thèmes un essai de typologie !
![]() C'est peut-être le plus intéressant en Art déco ; la
variété est non seulement considérable mais en plus susceptible de renouvellement. Bref des matières travaillées qui nous
éloignent des canons classiques des bronzes et marbres des
Beaux-Arts. Elles peuvent très bien être précieuses d'ailleurs,
comme plusieurs de ces exemples. Inversement, pour certaines
matières fréquentes en art déco et dans les arts populaires
(cuivres, étain, grès, etc. ) sont pour le moment absents de
cet aperçu... pas encore de furet en porcelaine.
C'est peut-être le plus intéressant en Art déco ; la
variété est non seulement considérable mais en plus susceptible de renouvellement. Bref des matières travaillées qui nous
éloignent des canons classiques des bronzes et marbres des
Beaux-Arts. Elles peuvent très bien être précieuses d'ailleurs,
comme plusieurs de ces exemples. Inversement, pour certaines
matières fréquentes en art déco et dans les arts populaires
(cuivres, étain, grès, etc. ) sont pour le moment absents de
cet aperçu... pas encore de furet en porcelaine.
|
|
Furet en argent, M.L.D., 2000 |
Argent : Design de Maggie Lee (ref. maggieleedesigns.com). Poids : 5 g.
|
|
Furet en bois, B.C., 2000 |
Bois : Râtelier à clés, en bois vernis. Travaillé à la main, création de Barbara Cramer. 15 cm x 10.
|
|
Furets en caoutchouc, Frettchenclub B., 2002 |
Caoutchouc : Figurines réalisées par le Berlin Frettchenclub, réalisation associative.
|
|
Furet en chocolat, T.F.S., 2001 |
Chocolat : Composition en chocolat au lait, 250 g. Produit exclusif de FerretStore. (ref. The FerretStore.com).
|
|
Furet en laiton, Frettchenclub B., 2002 |
Laiton : Production associative, du Club de Berlin (Berlin Frettchenclub).
|
|
Furet en or, M.L.D., 2000 |
Or : Design de Maggie Lee (ref. maggieleedesigns.com). Poids : 5 g., 14 c.
 |
|
Furet en textile, T.F.S. 2000 |
Textile : Peluche en fibre de polyester, taille 25x8cm.
![]() Quoi, des images ??? J'entends par là les types de
supports et de reproductions. c'est là qu'on voit mieux les
aspects techniques de l'art. On ne peut pas représenter et
exprimer le même chose selon qu'il s'agisse de sérigraphie,
peinture, gravure, moulage, etc. Et tout les modes de
reproduction ne sont pas compatibles avec toute matière, cela va de soit. Certains donneront du relief mais auront des traits
estompés, d'autres donneront une image plate mais aux traits
fins. L'impression de l'oeil ne sera pas du tout la même,
certains modes induisant un aspect vivant, d'autres plus hiératique, ou d'autres encore plus naïf, de l'animal.
Quoi, des images ??? J'entends par là les types de
supports et de reproductions. c'est là qu'on voit mieux les
aspects techniques de l'art. On ne peut pas représenter et
exprimer le même chose selon qu'il s'agisse de sérigraphie,
peinture, gravure, moulage, etc. Et tout les modes de
reproduction ne sont pas compatibles avec toute matière, cela va de soit. Certains donneront du relief mais auront des traits
estompés, d'autres donneront une image plate mais aux traits
fins. L'impression de l'oeil ne sera pas du tout la même,
certains modes induisant un aspect vivant, d'autres plus hiératique, ou d'autres encore plus naïf, de l'animal.
|
|
Image convexe, M.P.P., 2000 |
D'application classique, ce mug (25 cl) n'est pas anglais, mais produit par l'éleveur industriel américain de furets Marshall.
|
|
Image infographique, AJ. Pleine, 1998 |
Le site d'A.J. Pleine est connu des cyber amateurs du furet : images infographiques libres de droits (ref. basitech.com/ajl).
|
|
|
Image sur verre, A.A.C., 2000 |
Vitrail? : un terme abusif pour du verre peint et non de couleur ; Animal Art & Craft.
|
|
Image de joaillerie, Frettchenclub B., 2002 |
Côté relief, boucles d'oreilles en argent, Berlin Frettchenclub.
|
|
Image sérigraphiée, M.P.P., 2000 |
Sérigraphie ? Tapis à souris, support sur mousse, création et production de Marshall Pet Product. 22 cm.
![]() Des matières et des modes d'image,
mais pour faire quoi ? C'est probablement là que ressort le
mieux l'imagination des artistes... et aussi les débats sur la
finalité de l'art. Là on est en pleine brocante ! De ce
bric-à-brac, on peut retenir plusieurs types d'usages :
décoratifs, ludiques, informatifs, arts de la table. L'usage
d'un objet est porteur de sens : de fait, on n'utilise pas la
représentation de n'importe quel animal pour n'importe quel
usage. Ce n'est plus une question d'art mais de sciences
humaines. Que l'image du furet connaisse un usage ludique, c'est
signifiant de sa compatibilité avec l'idée que l'on se fait de
l'animal.
Des matières et des modes d'image,
mais pour faire quoi ? C'est probablement là que ressort le
mieux l'imagination des artistes... et aussi les débats sur la
finalité de l'art. Là on est en pleine brocante ! De ce
bric-à-brac, on peut retenir plusieurs types d'usages :
décoratifs, ludiques, informatifs, arts de la table. L'usage
d'un objet est porteur de sens : de fait, on n'utilise pas la
représentation de n'importe quel animal pour n'importe quel
usage. Ce n'est plus une question d'art mais de sciences
humaines. Que l'image du furet connaisse un usage ludique, c'est
signifiant de sa compatibilité avec l'idée que l'on se fait de
l'animal.
|
|
Broche, Frettchenclub B., 2002 |
Accessoire fantaisie : Broche du Berlin Frettchenclub (production associative).
|
|
Bouchon, T.F.S., 2000 |
Accessoire ménager : Bouchon pour bouteille peint, fabrication par TheFerretStore
|
| Calendrier, T.F.S., 2000 |
Animaux familiers et calendriers : un grand classique depuis des décennies. Une occasion aussi de penser à l'art photographique.
|
|
|
Pins, Frettchenclub B., 2002 |
Les pins : incontournables même si la grande époque est passée. Et en plis c'est une reproduction d'image d'art, d'un tableau très connu. Production associative, du Club de Berlin (Berlin Frettchenclub).
 |
|
Puzzle, P.S., 2000 |
On pourrait dire la même chose des enfants et des animaux. Création ludique de Pat Sherman ; c'est bien du bois, pas du carton : c'est un puzzle en relief.
 |
| Vaisselle, Frettchenclub B., 2002 |
Et bien sûr la vaisselle. On voit souvent le pire et le meilleur en assiette décorée o)... (Berlin Frettchenclub).
 |
| Vitrail, A.A.C., 2000 |
Décoration d'intérieur : Création Animal Art & Craft. Verre peint et armature métallique. Pour petit format de fenêtre.
![]()
Pour clore ce chapitre des Arts décos, j'ai voulu mettre en valeur un travail artistique de figurines sur commande, qui m'a été communiqué par Frédéric Lasserre de Toulouse. Il s'agit de modelages réalisés par une sculptrice toulousaine. Sur le site de l'artiste (http://www.loubersanes.com/), vous pourrez voir ses réalisations habituelles, essentiellement sur chiens, chats, et chevaux. Chris Loubersane est une passionnée à la fois des animaux (domestiques ou sauvages) et de la sculpture ; passions qu'elle a aujourd'hui réussit conjuguer dans son travail, sous forme humoristique ou sous forme plus classique, d'après modèle graphique ou d'après photo de l'animal. Techniquement, elle travaille essentiellement avec de l'argile, éventuellement avec pâte à bois et ossature métallique. A partir de boulettes d'argile, une forme est d'abord donnée par le travail des doigts et l'utilisation de petits ébauchoirs en bois ; les pièces sont creuses. Ensuite vient le séchage, à l'air libre puis au four. La couleur vient en dernier après la forme, avec peinture céramique ou de teinture de bois ; par dessus viendra s'ajouter le vernissage, avec une couche de finition à base de de vernis marins. Ces sculptures personnelles sont donc à chaque fois uniques, des "originaux". Selon la demande, le sujet pourra être traité soit de façon figurative "d'après photo", soit de façon stylisée (type caricature). Pour la faisabilité, il existe trois tailles de volumes de 5 à 25 cm (petite, moyenne et grande taille). Et plus qu'une simple représentation technique, on ne peut que saluer la volonté affichée de l'artiste et d'approche et de compréhension du monde animal.
|
|
|
Les deux images sont deux prises différentes de la même sculpture, malgré les apparences, comme quoi le même objet selon l'angle et la lumière peut apparaître différemment ; les moustaches ont été retaillées par le propriétaire (bonne taille mais diamètre trop gros). Il se trouve que ce modelage 2003 de duo de furet était d'autant plus un challenge que l'artiste n'avait jamais vu des furets auparavant ! ; en plus d'être une première, elle a travaillé sur photo et indications données par le maître des deux furets (précédemment demandeur pour un chat). La réalisation s'est fait sur bloc d'argile, et le fait est que cette première est assez remarquable et le rendu de pose fufutesque (on dirait qu'ils regardent leur maître) saisissant !
![]()
Oui, je sais, le cinéma fait partie des Arts du spectacle mais vous le trouverez au chapitre suivant (trop gros à caser o) ! )...
![]() Ceci n'est pas un canular (c'est pas le genre du site o),
mais juste une piste à vérifier. Je veux parler de la pièce de Marcel Pagnol
(le chantre de l'esprit provençal) Topaze, de 1928. Il est question dans
cette pièce du personnage principal Topaze qui est un humble et bon enseignant
qui va se muer progressivement en requin immoral. Dans les 2 premiers actes ont
le voit entre autres s'occuper de sa classe en amenant un putois à ses
élèves, de chez lui il s'agit d'un putois empaillé, comme il est écrit
dans la scène 3 de l'acte I :
Ceci n'est pas un canular (c'est pas le genre du site o),
mais juste une piste à vérifier. Je veux parler de la pièce de Marcel Pagnol
(le chantre de l'esprit provençal) Topaze, de 1928. Il est question dans
cette pièce du personnage principal Topaze qui est un humble et bon enseignant
qui va se muer progressivement en requin immoral. Dans les 2 premiers actes ont
le voit entre autres s'occuper de sa classe en amenant un putois à ses
élèves, de chez lui il s'agit d'un putois empaillé, comme il est écrit
dans la scène 3 de l'acte I :
MUCHE: "Parfait." (Il montre le petit animal empaillé sur le bureau) "Quel est ce mammifère?"
TOPAZE: "C'est un putois. monsieur le directeur. Il m'appartient. mais je l'ai apporte pour illustrer une leçon sur les ravageurs de la basse-cour."
Quel rapport avec le furet ? Oui, il n'est pas question de furet dans le texte de la pièce ; mais la question se pose au niveau de la mise en scène ! Un putois empaillé, ça ne se trouve pas aussi facilement, que ce soit pour les accessoiristes de théâtre comme pour les taxidermistes... Et d'un autre côté on voit mal un furet rester sagement sur un décor de théâtre ! C'est là qu'il faudrait vérifier comment les metteurs en scène et accessoiristes ont résolu la question, selon les mises en scène de la pièce jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu trois films aussi, dont deux de Pagnol lui-même en 1936 et 1950 (dans l'un d'entre eux la difficulté d'accessoire a été tournée, le putois devenant ...écureuil !
![]() En commençant le site, j'étais très loin d'y penser, mais si :
En commençant le site, j'étais très loin d'y penser, mais si : 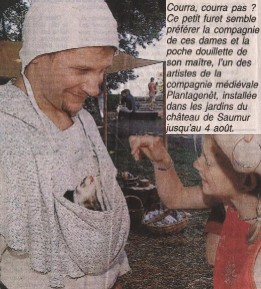 au
hasard des navigations sur Internet, voilà un exemple d'utilisation du furet
dans les Arts du Spectacle ! Ca se passe en Anjou, où il existe une troupe
d'amateurs d'histoire qui produit des scènes de reconstitutions médiévales
: la Compagnie Plantagenêt. Tout sous forme d'animation de site, en contact
avec le public : vous pouvez les voir à l'œuvre à la page http://perso.wanadoo.fr/mjc.saumur/acc/planta/index.htm
de la M.J.C. de Saumur, et elle a
fait l'objet de commentaires élogieux dans la presse régionale. Le groupe est
spécialisé dans les XII°-XIII° siècles, les siècles du milieu du Moyen-age
ou " Beaux-siècles " médiévaux comme le veut l'expression des
anciens manuels Malet et Isaac... Il s'agit de montrer au public différents
aspects de la vie au Moyen-Age, différentes scènes, différentes facettes, le
tout avec un soucis prioritaire de réalité historique ; avec un important
travail préalable de recherche documentaire historique, y compris sur le furet.
Le membre propriétaire de furet en possède deux femelles, qui sont
parfaitement rodées au chaperon de leur maître depuis deux ans !
au
hasard des navigations sur Internet, voilà un exemple d'utilisation du furet
dans les Arts du Spectacle ! Ca se passe en Anjou, où il existe une troupe
d'amateurs d'histoire qui produit des scènes de reconstitutions médiévales
: la Compagnie Plantagenêt. Tout sous forme d'animation de site, en contact
avec le public : vous pouvez les voir à l'œuvre à la page http://perso.wanadoo.fr/mjc.saumur/acc/planta/index.htm
de la M.J.C. de Saumur, et elle a
fait l'objet de commentaires élogieux dans la presse régionale. Le groupe est
spécialisé dans les XII°-XIII° siècles, les siècles du milieu du Moyen-age
ou " Beaux-siècles " médiévaux comme le veut l'expression des
anciens manuels Malet et Isaac... Il s'agit de montrer au public différents
aspects de la vie au Moyen-Age, différentes scènes, différentes facettes, le
tout avec un soucis prioritaire de réalité historique ; avec un important
travail préalable de recherche documentaire historique, y compris sur le furet.
Le membre propriétaire de furet en possède deux femelles, qui sont
parfaitement rodées au chaperon de leur maître depuis deux ans !
| La République du Centre-Ouest, 30.07.02 |
A la télévision on a pu apercevoir furtivement un furet le soir du 27 Mai 2003, dans l'émission Vis ma vie. C'est une émission people de deuxième partie de soirée de TF1 (pléonasme) où deux personnes de vie totalement opposées se rencontrent, l'un partageant qq jour la passion abhorrée de l'autre... Ce soir là un "urban-tendance" branché était immergé dans le camp d'une compagnie d'animation médiévale ! Le furet appartenait à la compagnie Para Bellum, spécialisée dans le XV° Siècle et l'animation militaire (archerie, campement, combats, démonstrations, forge et étains, vie quotidienne médiévale sur campement). Dans la sène de l'émission, le furet (un putoisé) n'était rien de moins que sur la table de banquet où il marchait allègrement entre les plats (mise en scène pour la caméra ?) ! Après les chiens de banquet, les furets ? o) La troupe est basée à Rubécourt dans les Ardennes ; ses coordonnées sont visibles sur le portail Webieval (évènement, groupes, marchants, musées, sites historiques, etc.). Portail où l'on trouve aussi mention d'une Compagnie du Furet en Belgique (Wallonie) sur Trévieusart ; elle s'est déjà produite aussi entre autre à Couvin, Mons, et dans le grand moment que sont les Euromédiévales de Tournai. Elle aussi est spécialisée sur la fin du Moyen-Age (XIV°-XV° siècles).
Et on aura plaisir à terminer
le voyage par la compagnie Ante Revelare, dont le site
permet voir des photos des furets sur la page de présentation de l'association et à la
page Compagnons
! Depuis deux ans, la troupe produit des animations médiévales sur les terres
de Guyenne (Dordogne, Corrèze, Lot) ; avec de nombreuses photos, vous attendent
: fêtes et animations, taillanderie, bouche-à-feux (spécialité explosive de
la compagnie o), enluminures, compagnons, liens (et avec une "cage à
rats" au milieu des armes). Même centrée sur le Moyen-Age, la troupe
couvre un champ chronologique élargi de l'Antiquité à la fin du Moyen-Age
pour montrer selon les villes et les saisons : vie quotidienne, forge, bouches
à feu ou furets (pas les deux en même temps), réalisation d'enluminures,
fabrication de cotte de maille, et travail du cuir. Vous pouvez aussi y louer
des costumes pour vos propres fêtes !
des photos des furets sur la page de présentation de l'association et à la
page Compagnons
! Depuis deux ans, la troupe produit des animations médiévales sur les terres
de Guyenne (Dordogne, Corrèze, Lot) ; avec de nombreuses photos, vous attendent
: fêtes et animations, taillanderie, bouche-à-feux (spécialité explosive de
la compagnie o), enluminures, compagnons, liens (et avec une "cage à
rats" au milieu des armes). Même centrée sur le Moyen-Age, la troupe
couvre un champ chronologique élargi de l'Antiquité à la fin du Moyen-Age
pour montrer selon les villes et les saisons : vie quotidienne, forge, bouches
à feu ou furets (pas les deux en même temps), réalisation d'enluminures,
fabrication de cotte de maille, et travail du cuir. Vous pouvez aussi y louer
des costumes pour vos propres fêtes !
![]()
Si ! Je parle bien du cinéma, pas de télévision. On peut trouver des figurations du furet dans le Septième art, et depuis le début du XX° Siècle ! Au delà de simples apparitions naturalistes (encore une piste à creuser !). Disons-le d'entrée, les cinéphiles vont être déçus ! A priori, on se dit que l'on a plus de chance de voir des figurations du furet dans des films récents, américains, de comédie familiale, que dans un Clouzot d'avant 1945 ou dans un Truffaut. Il y a une logique derrière, qui est celle de l'usage domesticatoire du furet ; on voit mal un film sur la tragédie Yougoslave avec un petit animal qui fait des bonds dans les jambes avec des " cot-cot-cot ", sauf à faire du tragi-comique à la Bellini. On peut aussi avancer que c'est souvent le lot commun des films à apparitions animalières, ou du moins ceux où ils replissent un rôle dans le film. Maintenant, il y a forcément des domaines à creuser auxquels on ne pense pas (je verrais bien le furet dans des pastiches de film d'horreur °)) ; et il faudrait que je vois du côté des films qui traitent des braconniers. Il n'y en a curieusement pas dans Ni vu ni connu d'Yves Robert en 1957, où Louis de Funès jouait "Blaireau", braconnier historique (mon magnétoscope est formel) ; idem pour La règle du jeu du grand Renoir en 1939 (avec J. Carette jouant Marceau). Parmi les fausses pistes, on trouvera Ladyhawke, Elizabeth, La dame de Windsor et Qui veut la peau de Roger Rabbit? (dans la VF il est question de fouines)... Si vous avez plus d'information, un courrier sera toujours le bienvenu !
Autre chose importante après
les figurations de furet : les dresseurs animaliers, "animal
trainers" pour les films américains (le terme en anglais est
sémiologiquement plus doux que le terme français ;-). Autrefois, les
cinéastes faisaient appel à des dresseurs de cirque qui venaient avec leurs
propres animaux, puis au fil des décennies, certains animaliers se sont
spécialisés dans les prestations de cinéma et télévision. Il serait intéressant de savoir
comment ils ont travaillé avec les furets, combien ils ont ont utilisés pour
leur séquence, etc... Certains se sont organisés comme de vraies petites
entreprises. Le plus important dans le cas du furet est sans conteste Brian
MacMillan : sur les décennies 70, 80 et 90 il a travaillé sur pas moins de 90
films !!! Beaucoup de navets ou de films inconnus chez nous, mais pas seulement
: en 1981 il était sur La Guerre du Feu de Jean-Jacques Annaud. Mais sur
le furet, il est surtout connu pour la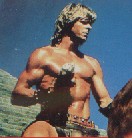 série des trois Dar l'Invincible
en 1982, 91 et 95 (The Beastmaster en V.O. et EL Señor
de las Bestias en V.E.).
Sans en être les créatures principales de la série, les furets y sont bien
mis en valeurs comme animaux du héros ; ces films sont probablement ce qui ont
le plus fait dans la valorisation et la popularisation du furet puisque bien
connus dans leur catégorie du Médiéval-Fantastique. Pour beaucoup (et
internationalement si j'en juge à ce que j'ai vu sur le forum espagnol), ses
films furent la première découverte du furet. Ce qui est connu et figure aux
génériques, c'est que les furets en question ont étés fournis aux États-Unis,
par la célèbre et controversée entreprise Marshall Farms. La bonne question
serait de savoir si la firme a contribué au financement du film...
série des trois Dar l'Invincible
en 1982, 91 et 95 (The Beastmaster en V.O. et EL Señor
de las Bestias en V.E.).
Sans en être les créatures principales de la série, les furets y sont bien
mis en valeurs comme animaux du héros ; ces films sont probablement ce qui ont
le plus fait dans la valorisation et la popularisation du furet puisque bien
connus dans leur catégorie du Médiéval-Fantastique. Pour beaucoup (et
internationalement si j'en juge à ce que j'ai vu sur le forum espagnol), ses
films furent la première découverte du furet. Ce qui est connu et figure aux
génériques, c'est que les furets en question ont étés fournis aux États-Unis,
par la célèbre et controversée entreprise Marshall Farms. La bonne question
serait de savoir si la firme a contribué au financement du film...
| Le furet Podo, Dar l'Invincible 1982 |
D'une manière plus générale, il y a moyen de savoir comment les animaux ont étés utilisés dans tel ou tel film, en allant sur le site américain de l'A.H.A. ; véritable institution, l'American Human Association est une association de protection animale qui entre autres activités, contrôle et conseille l'utilisation des animaux dans les tournages (visionnages et présence sur plateaux). D'abord au cas par cas de 1940 à 1980, puis de façon systématique après (accords avec l'industrie cinématographique et le syndicat des acteurs Screen Actors Guild), pour accorder ou non le label " No Animals Were Harmed™ " (aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage). La faille du système est simplement qu'il s'agit d'une association nationale et concerne le seul cinéma américain, même si l'AHA a ponctuellement pu collecter des informations sur des productions canadiennes, mexicaines, voire européennes ou sur des coproductions (comme sur Le Seigneurs des Anneaux avec la Nouvelle-Zélande). Pour le cinéma européen, français, ou exotique, faute d'un outil comparable il faut aller chasser les informations au cas-par-cas... :-( Grosso modo, on retiendra l'axiome général que plus un film est récent, plus l'information animalière est facile à trouver !
Sur les petits poilus, on dispose ainsi d'informations très détaillées sur le travail des furets dans une demi-douzaine de films américains depuis les Années 90. Presque systématiquement, plusieurs furets semblables étaient présents sur le tournage, par doublure et surtout à cause de leur temps d'attention et d'activité limités ; plus rarement aussi, les plans avec furet ont étés tournés séparément puis superposés. De manière synthétique, ça nous donne le tableau suivant, sur l'ensemble des scènes au furet dans chaque film, manifestement sans fouet ni bâton :
|
FILMS |
TECHNIQUES |
ANIMATRONIQUE |
| Un flic à la maternelle (1990) | nourriture | O |
| Dar l'Invincible II (1991) | nourriture | O |
| Starship troopers (1997) | pouic-pouic | N |
| The Big Lebowski (1998) | autre | O |
| Le Seigneur des Anneaux (2001) | nourriture | N |
| Dreamcatcher (2003) | nourriture | N |
| Polly et moi (2003) | nourriture + pouic-pouic | O |
On voit que des deux techniques principales utilisées par les dresseurs (dans The Big Lebowski c'est simplement à la main qu'à été dirigé et plongé le furet ;-), c'est plus souvent à la nourriture (récompense) à qui on a eu recours qu'au " pouic-pouic ". Les sources anglo-saxones sur le cinéma parlent généralement du terme de buzzer, qu'on peut traduire par " vibreur " ou " pouic-pouic " ; il faut donc s'imaginer, quand on voit une scène de film, qu'au moment du tournage il y avait sans doute un furet seul au milieu du plateau, plein de techniciens autour pour le filmer, et avec un gugusse en train de faire couiner un pouic-pouic à l'autre bout !
![]()
![]() C'est quoi ce truc ? Oui, alors avec un titre comme ça, ce n'est pas un film comme un autre :
d'une part c'est un documentaire, et d'autre part il s'agirait de l'un des plus
anciens films où figure le furet ! Ancien, c'est le moins que l'on puisse dire
ce documentaire date du temps du cinéma muet ! Ce film est une
compilation de 18 courts-métrages tournés entre 1912 et 1914 par les
Actualités Gaumont, pour servir comme documentaire pédagogique en Sciences
Naturelles, sur les animaux sauvages et domestiques (on y voit que les rubans
pour chien-chiens ne datent pas d'aujourd'hui). Grâce à la vidéo et à
l'informatique, il est possible de consulter ce film à la Bibliothèque
Nationale de France (salle de l'audiovisuel) sous la cote IKM004513-3. La
séquence au furet est la séquence n° 10 (Gaumont Actualités / Série
Enseignement n°4377). La
référence : Recueil Sciences naturelles. 2 ; France 1915 ; Gaumont (prod.
et dist.) ; 59 mn : vidéo SVHS, noir-et-blanc, muet. Je ne peux pas vous
montrer d'images : c'est d'autant plus regrettable que par rapport aux autres
films du recueil souvent abîmés, le film est parfaitement visible pour peu
qu'on le règle (il est très sombre) et qu'on le passe au ralenti.
C'est quoi ce truc ? Oui, alors avec un titre comme ça, ce n'est pas un film comme un autre :
d'une part c'est un documentaire, et d'autre part il s'agirait de l'un des plus
anciens films où figure le furet ! Ancien, c'est le moins que l'on puisse dire
ce documentaire date du temps du cinéma muet ! Ce film est une
compilation de 18 courts-métrages tournés entre 1912 et 1914 par les
Actualités Gaumont, pour servir comme documentaire pédagogique en Sciences
Naturelles, sur les animaux sauvages et domestiques (on y voit que les rubans
pour chien-chiens ne datent pas d'aujourd'hui). Grâce à la vidéo et à
l'informatique, il est possible de consulter ce film à la Bibliothèque
Nationale de France (salle de l'audiovisuel) sous la cote IKM004513-3. La
séquence au furet est la séquence n° 10 (Gaumont Actualités / Série
Enseignement n°4377). La
référence : Recueil Sciences naturelles. 2 ; France 1915 ; Gaumont (prod.
et dist.) ; 59 mn : vidéo SVHS, noir-et-blanc, muet. Je ne peux pas vous
montrer d'images : c'est d'autant plus regrettable que par rapport aux autres
films du recueil souvent abîmés, le film est parfaitement visible pour peu
qu'on le règle (il est très sombre) et qu'on le passe au ralenti.
Le film dure environ 5 mn. L'intitulé est assez surréaliste : " Les animaux de nos forêts : le furet ; le putois et sa variété blanche. " Hum-hum... Il y a comme qui dirait de la confusion entre furet et putois, dans l'air. Il y a deux parties avec les bons vieux panneaux noirs ("Le putois (Putorius foetidus) et sa variété blanche : le furet" et "Le furet et sa proie"), ce qui représente une dizaine de séquences. Cette étrange taxonomie du putois date, effectivement, et fait penser aux anciennes étiquettes de la Galerie d'Anatomie comparée du Muséum National d'Histoire Naturelle.
|
Action 1 : dans un parc. |
On voit un albinos et un putoisé fureter truffe au sol, mettant en valeur leur morphologie et locomotion spécifique. |
|
Action 2 : gamelle de pain trempé au lait. |
No comment. On remarque que l'albinos est plus petit et que même en noir-et-blanc, il a le poil assez sale. |
|
Action 3 : lapin et putoisé séparés par une vitre. |
Ben, le lapin ne s'agite pas dans tous les sens à la vue du furet ...par contre le furet a manifestement envie de rejoindre le lapin ! |
|
Action 4 : transport. |
Les modes de transport de de contention traditionnels. On voit un sac à furet façon "porte-monnaie géant" en cuir noir, exactement le modèle décrit dans le livre de P. Mégnin à la page Histoire4. Tout comme on voit que le furet voulait absolument garder la tête à l'extérieur, comme ceux d'aujourd'hui... |
Actions 5 à 9 : terrier reconstitué. |
Quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent : comment c'est à l'intérieur d'un terrier ? En coupe avec une façade de verre, les auteurs ont reconstitué une morceau de terrier de lapin, avec entrée verticale. Il y a plusieurs séquences secondaires. On y voit d'abord deux lapins seuls, comment ils bougent dedans ; puis idem avec un furet albinos, introduit avec une petite poussette sur les fesses. En réalité il y a un montage à ce moment car l'introduction se fait dans une entrée horizontale. Lapin + furet ? Ben l'albinos poursuit en 4° vitesse les lapins, et la vitesse avec laquelle ils ressortent (d'une entrée horizontale) ! Même action ensuite avec un putoisé, porteur d'un collier à grelots. Et là, on voit bien une attitude de jeu bien connue aujourd'hui : le frétillement de la queue, quand le furet est excité (en l'occurrence il ne voit pas le lapin mais perçoit manifestement ses mouvements). Et le filet de capture pour la dernière action ; on voit très bien la pause, légère, et son caractère coulissant avec le lapin serré comme un saucisson après la percution du filet ! o) |
|
Action 10 : introduction du lapin. |
Assurément le passage le plus bizarre du film... Une personne introduit un lapin mort à l'entrée d'un terrier ! En réalité ça semble être un procédé pour faire revenir le furet, car le lapin est agité comme une peluche ...et d'ailleurs il mord à l'hameçon. |
|
Action 11 : présentation dans les mains. |
Ca nous permet surtout de voir des furets en gros plan. Le putoisé présenté est un gros mâle à museau court, bien calme. A rebours de la légende, l'albinos est le plus agité et monte même sur l'épaule du montreur. Et pour terminer, le clou final : la pose d'un collier à grelots sur le putoisé, assez réfractaire à la manœuvre. Détail curieux, le démonstrateur est muni de gants (passons...), mais en plus d'élégants gants noirs de ville ! |
Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Ben il est où le putois ? Manifestement nulle part dans le film... On a simplement des furets putoisés, très calmes et pas spécialement sombres. A priori le film ne semple pas avoir été fait par un naturaliste, et donne plus dans le pittoresque que dans le film zoologique. Nos réalisateurs d'Avant-Guerre sont tombés dans le panneau de la confusion furet/putois. Tiens, une devinette pour finir : combien de génération de furets nous séparent de ces furets de 1914 ?
![]()
![]() Si je vous disais comment j'ai trouvé cette
référence... enfin. Disons que ça sert de fréquenter les
officines de bouquinistes et d'imagiers : on trouve des fois des
trucs au fonds des tiroirs, bref
Si je vous disais comment j'ai trouvé cette
référence... enfin. Disons que ça sert de fréquenter les
officines de bouquinistes et d'imagiers : on trouve des fois des
trucs au fonds des tiroirs, bref 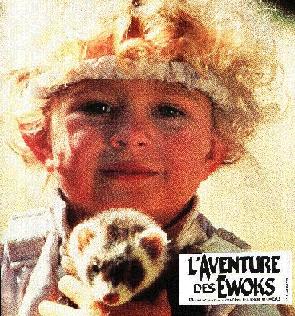 c'est
dû au hasard. En tout cas, il n'y a pas de confusion entre ewoks
(petits "oursons" aborigènes apparus dans le Retour du
Jedi) et les furets ; la photo est là pour le prouver. La
référence : L'aventure des ewoks (titre original " Caravan
of courage : an ewoks adventure" ; USA 1984,
réalisateur : John Korty; scénariste : Bod Carrau, musique :
Peter Bernstein ; prod. Georges Lucas, dist. 20th Century Fox ;
scope coul., dolby, 103 mn. Les illustres acteurs inconnus ? Eric
Walker, Aubrer Miller, Warwick Davis. Hormis qu'il s'agit d'un
univers à la Georges Lucas (qui en est le directeur artistique)
la seule chose que je savais, c'est qu'il s'agit d'un film pour
enfants. Tel qu'il m'a été signalé, le rôle
cinématographique des deux furets putoisés du film, c'est celui
d'être des animaux de compagnie, d'ailleurs charmants ; leurs
apparitions à l'écran sont brèves, mais fréquentes tout au
long du film. Finalement, tout en étant un film de SF, c'est un
film où les furets jouent parfaitement leur rôle et les montre
bien à leur place réelle.
c'est
dû au hasard. En tout cas, il n'y a pas de confusion entre ewoks
(petits "oursons" aborigènes apparus dans le Retour du
Jedi) et les furets ; la photo est là pour le prouver. La
référence : L'aventure des ewoks (titre original " Caravan
of courage : an ewoks adventure" ; USA 1984,
réalisateur : John Korty; scénariste : Bod Carrau, musique :
Peter Bernstein ; prod. Georges Lucas, dist. 20th Century Fox ;
scope coul., dolby, 103 mn. Les illustres acteurs inconnus ? Eric
Walker, Aubrer Miller, Warwick Davis. Hormis qu'il s'agit d'un
univers à la Georges Lucas (qui en est le directeur artistique)
la seule chose que je savais, c'est qu'il s'agit d'un film pour
enfants. Tel qu'il m'a été signalé, le rôle
cinématographique des deux furets putoisés du film, c'est celui
d'être des animaux de compagnie, d'ailleurs charmants ; leurs
apparitions à l'écran sont brèves, mais fréquentes tout au
long du film. Finalement, tout en étant un film de SF, c'est un
film où les furets jouent parfaitement leur rôle et les montre
bien à leur place réelle.
| Photo cinéma, 1984 |
![]()
![]() Il y a plusieurs années j'ai
vu deux films à la suite de médiéval-fantastique ; l'un des
deux présentait des furets... et l'un des deux était Ladyhawke
(plus sentimental qu'héroïque d'ailleurs). J'hésitait entre
celui-là et un autre titre. Problème : pas de magnétoscope à ce moment, et webmestres des sites sur Ladyhawke ne répondaient
pas. J'ai la réponse grace au webmaster de Griffon : pour le moment, la
figuration de furet la plus longue que je connaisse est donc dans
le film Dar l'Invincible. Le tout corsé par la différence de noms du film
entre les pays (The Beastmaster en V.O., Dar l'Invincible en V.F.).
La référence : Dar l'Invincible ; USA
1982, réalisateur et scénariste : D.A. Coscarelli ; photographe
: , décorateur : , musique : L. Holdrige ; prod. et dist. MGM ;
scope coul., dolby, 119 mn. Les acteurs ? M. Singer, R. Torn, T.
Roberts, J. Amos, ... Les furets ont étés fournis par l'entreprise Gentle
Jungle. Beastmaster ça veux dire le "Seigneur des Animaux" :
Dar a reçu le don de communiquer avec les animaux, et peut même voir par leurs
yeux, à distance. Le scénario nous place dans des temps très primitifs où
s'engage une lutte contre des nomades barbares et des prêtres fanatiques menés
par Méax (pas cool les sacrifices humains). En plus de son équipement (léger,
Dar est un guerrier fluet à l'échelle du Médiéval-Fantastique) et de la compagnie d'une panthère
noire et d'un aigle, le héros
possède les deux furets dans leur quête. Ils s'appelaient dans le film Podo et Kodo (noms donnés dans
les différentes versions), ce sont deux
putoisés (j'ignore si sur la durée du tournage le dresseur de
cinéma en a utilisé plus, mais c'est assez probable).
Il y a plusieurs années j'ai
vu deux films à la suite de médiéval-fantastique ; l'un des
deux présentait des furets... et l'un des deux était Ladyhawke
(plus sentimental qu'héroïque d'ailleurs). J'hésitait entre
celui-là et un autre titre. Problème : pas de magnétoscope à ce moment, et webmestres des sites sur Ladyhawke ne répondaient
pas. J'ai la réponse grace au webmaster de Griffon : pour le moment, la
figuration de furet la plus longue que je connaisse est donc dans
le film Dar l'Invincible. Le tout corsé par la différence de noms du film
entre les pays (The Beastmaster en V.O., Dar l'Invincible en V.F.).
La référence : Dar l'Invincible ; USA
1982, réalisateur et scénariste : D.A. Coscarelli ; photographe
: , décorateur : , musique : L. Holdrige ; prod. et dist. MGM ;
scope coul., dolby, 119 mn. Les acteurs ? M. Singer, R. Torn, T.
Roberts, J. Amos, ... Les furets ont étés fournis par l'entreprise Gentle
Jungle. Beastmaster ça veux dire le "Seigneur des Animaux" :
Dar a reçu le don de communiquer avec les animaux, et peut même voir par leurs
yeux, à distance. Le scénario nous place dans des temps très primitifs où
s'engage une lutte contre des nomades barbares et des prêtres fanatiques menés
par Méax (pas cool les sacrifices humains). En plus de son équipement (léger,
Dar est un guerrier fluet à l'échelle du Médiéval-Fantastique) et de la compagnie d'une panthère
noire et d'un aigle, le héros
possède les deux furets dans leur quête. Ils s'appelaient dans le film Podo et Kodo (noms donnés dans
les différentes versions), ce sont deux
putoisés (j'ignore si sur la durée du tournage le dresseur de
cinéma en a utilisé plus, mais c'est assez probable).
Kodo c'est le putoisé sombre,
et Podo c'est la putoisée claire. Je ne vous
raconte pas la suite... Comme souvent dans la mise scène
animalière au cinéma, ces animaux sont très
intelligents : ils comprennent beaucoup d'ordres, et des
phrases entières en français (en V.F.), et en anglais (V.O.)
°) ! Pour qui connaît un minimum les furets, ils il y aussi des
choses remarquables. Ces deux furets sont extrêmement calmes et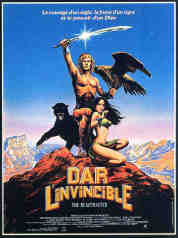 patients : il ne sortent de leur sac en bandouillère que lorsque
l'on a besoin d'eux (pratique!). Et en plus ils obéissent aussi
bien que des chiens ; le héros est un remarquable dresseur
(c'est pour ça que c'est le Maître des Animaux). Entre autres,
Podo et Kodo ont une intervention décisive dans le scénario,
lorsque leur maître est enfermé dans une prison sordide ;
pouvant se faufiler partout et bon chercheurs, ils arrivent à
trouver et rapporter les clés aux héros et poursuivis par un
Garde de la Mort ! Si
vous arrivez aussi à faire rapporter par votre furet au lieu
qu'il vole un objet, téléphonez de suite à l'Académie des
Sciences : ça restera dans les annales scientifiques... Pour l'utilisation du
furet dans un scénario, voilà en tout cas une illustration de la morale de La
Fontaine " on a toujours besoin d'un plus petit que soi "... même
quand on est un warrior ! On dira que le film met bien en valeur le côté
espiègle et voleur du furet (c'est d'ailleurs comme ça que Dar fait la
connaissance du couple de furet au départ) ; c'est d'ailleurs bien pratique
quand il s'agit de voler les flèches des arbalètes des adversaires, dans un
bon timing o). A la fin, ça se termine mal pour le mâle, mais la vie prenant
le dessus la femelle se retrouve avec une portée !
patients : il ne sortent de leur sac en bandouillère que lorsque
l'on a besoin d'eux (pratique!). Et en plus ils obéissent aussi
bien que des chiens ; le héros est un remarquable dresseur
(c'est pour ça que c'est le Maître des Animaux). Entre autres,
Podo et Kodo ont une intervention décisive dans le scénario,
lorsque leur maître est enfermé dans une prison sordide ;
pouvant se faufiler partout et bon chercheurs, ils arrivent à
trouver et rapporter les clés aux héros et poursuivis par un
Garde de la Mort ! Si
vous arrivez aussi à faire rapporter par votre furet au lieu
qu'il vole un objet, téléphonez de suite à l'Académie des
Sciences : ça restera dans les annales scientifiques... Pour l'utilisation du
furet dans un scénario, voilà en tout cas une illustration de la morale de La
Fontaine " on a toujours besoin d'un plus petit que soi "... même
quand on est un warrior ! On dira que le film met bien en valeur le côté
espiègle et voleur du furet (c'est d'ailleurs comme ça que Dar fait la
connaissance du couple de furet au départ) ; c'est d'ailleurs bien pratique
quand il s'agit de voler les flèches des arbalètes des adversaires, dans un
bon timing o). A la fin, ça se termine mal pour le mâle, mais la vie prenant
le dessus la femelle se retrouve avec une portée !
| Affiche de sortie française, 1982 |
Ce qui n'est pas réaliste par contre quand on connaît le furet -outre le fait de tout comprendre et de rapporter-, c'est par exemple que les 2 furets de son couple aient la même taille... Encore plus surprenant : les cris des furets ! Le furet étant un animal peu sonore et ne pout-poutant pas sur commande sur le plateau de tournage, les bruits des furets ont manifestement étés rajoutés au montage ; Podo et Kodo font des bruits entre le ouistiti et Flipper le dauphin et les caquètements d'oiseaux exotiques de chez Truffaut ! o) Mais en tout cas un film beaucoup moins bidon que des Kalidor et compagnie, moins carton-pâte et accessoires en plastique. Différent aussi de l'esthétisme wagnérien d'un Conan, Dar est plus orienté sur la sorcellerie. A vous de juger.
Avant même de parler des suite
de Dar au cinéma, il y a un signe du succès de la formule qui ne trompe pas :
il y a eu une adaptation à la télévision. Une coproduction australo-canadienne
a crée une série télé en 1999. Sur Internet, vous avez d'ailleurs
plus de chance de trouver des sites sur le feuilleton que sur le film...  Silvio Tabet
est revenu superviser ce remake, pour garder un minimum de cohérence (quoique
entre le film I et III il y a un hiatus énorme), et c'est Daniel Goddard qui
reprend le rôle de Dar. Si ça ne vous dit rien c'est normal, les chaîne de télé
françaises n'ayant pas été intéressées par l'achat de la série à son
lancement, par
contre les québécois devaient connaître ; la série a commencé à âtre
visible en 2003 sur la chaîne satellite AB1.
Le responsable animalier de
la série est l'australien Tony Jablonski, qui travaille dans ce domaine depuis
plus de 25 ans, même s'il est plus connu pour ses dressages de chevaux comme
ceux de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000.
Silvio Tabet
est revenu superviser ce remake, pour garder un minimum de cohérence (quoique
entre le film I et III il y a un hiatus énorme), et c'est Daniel Goddard qui
reprend le rôle de Dar. Si ça ne vous dit rien c'est normal, les chaîne de télé
françaises n'ayant pas été intéressées par l'achat de la série à son
lancement, par
contre les québécois devaient connaître ; la série a commencé à âtre
visible en 2003 sur la chaîne satellite AB1.
Le responsable animalier de
la série est l'australien Tony Jablonski, qui travaille dans ce domaine depuis
plus de 25 ans, même s'il est plus connu pour ses dressages de chevaux comme
ceux de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000.
Si vous voulez approfondir cette thématique, il existe le site suédois Griffon, qui s'y connaissent en furet, SF et Fantastique. Pour info, il a fallu deux mois (et une encyclopédie exhaustive du cinéma) pour retrouver les références du film, dont j'avais oublié le nom... heureusement en faisant d'autres choses à côté °). Patience : ce n'est pas encore que vous aurez une vidéo sur ce site !
![]()
![]() DAR l'INVINCIBLE II : (tout
au long du film, plusieurs mn). Houuuuuuu le navet !!! Ha ben ils ont
changé de réalisateur et ça se voit : il est franchement raté celui-là, et je n'ai trouvé
aucun avis contraire sur Internet. C'est limite parodie de Bioman par les
Inconnus... L'histoire ? Alors une sorcière ambiguë
donne une mauvaise idée au tyran Arklon : elle possède le
DAR l'INVINCIBLE II : (tout
au long du film, plusieurs mn). Houuuuuuu le navet !!! Ha ben ils ont
changé de réalisateur et ça se voit : il est franchement raté celui-là, et je n'ai trouvé
aucun avis contraire sur Internet. C'est limite parodie de Bioman par les
Inconnus... L'histoire ? Alors une sorcière ambiguë
donne une mauvaise idée au tyran Arklon : elle possède le secret des portes du
temps et lui montre ce qu'est un détonateur nucléaire au XX° Siècle. Une
gamine va se retrouver sur cette route, mais heureusement Dar aussi...
Empêchera-t-il l'usage de l'arme nucléaire en univers Médiéval-Fantastique ?
o) La référence : Dar l'Invincible II : Au delà des Portes du Temps ;
USA 1991, réalisateur : Silvio Tabet ; prod. et dist. : ; coul., dolby SR,
107 mn. Les acteurs : M. Singer, W. Hauser, S. Douglas, K. Wuhrer... A la
différence du I, les furets ont étés fournis par l'entreprise Marshall Farms.
secret des portes du
temps et lui montre ce qu'est un détonateur nucléaire au XX° Siècle. Une
gamine va se retrouver sur cette route, mais heureusement Dar aussi...
Empêchera-t-il l'usage de l'arme nucléaire en univers Médiéval-Fantastique ?
o) La référence : Dar l'Invincible II : Au delà des Portes du Temps ;
USA 1991, réalisateur : Silvio Tabet ; prod. et dist. : ; coul., dolby SR,
107 mn. Les acteurs : M. Singer, W. Hauser, S. Douglas, K. Wuhrer... A la
différence du I, les furets ont étés fournis par l'entreprise Marshall Farms.
|
Détail de la couverture vidéo, 1991 |
Qu'est-ce qui ne vas pas dans
ce film ? Il vaudrait mieux demander ce qu'il va ! o) Déjà, il n'est pas
cohérent avec le I ; passons. Le scénario déjà est
assez "énorme" et les moments forts n'en sont pas : c'est tout
plat... Le jeux des acteurs surtout est une catastrophe, le personnage d'Arklon
est une caricature ridicule qui n'impressionnerait pas un enfant de 4 ans, et le
jeu des autres personnages ne vaut pas mieux ; à la limite, c'est le personnage
de Dar qui s'en sort le mieux. Il faut dire que les dialogues qu'on leur fait
tenir ne font rien pour entretenir un souffle épique et wagnérien, qui fit
tellement la beauté du Médiéval-Fantastique. Et que dire de l'équipe
technique ? On se demande si le film a été réalisé avec le budget d'un film
albanais, au vu des rochers en polystyrène qui rebondissent presque sur le sol
! On a une donne idée du film en voyant la couverture grotesque de la vidéo,
où les furets (un dans le sac l'autre sur le tigre) font vraiment photomontage
grossier. A la limite, Silvio Tabet aurait pu faire une parodie dans le style Visiteurs,
mais même côté humour l'électroencéphalogramme est plat... Bref un film à louer, comme j'ai fait, si vous avez un gros abonnement mais
surtout
pas à acheter. o) Et les furets dans tout ça ? Ben ils voyagent toujours dans
le sac de Dar -bien sagement sans avoir l'envie d'en sortir- et sont très
attachés à leur maître, puisque dans un séquence du début l'un des deux
mord au mollet un guerrier adverse à un moment très judicieux (il allait
attaquer son maître par derrière). La scène que vous voyez c'est un bisou
entre un aigle (Sharak) et un furet ! Quand on sait à quel point les rapaces
sont des bourreaux de mustélidés, c'est vraiment une faute de goût... La fin
d'ailleurs, où Dar
donne Podo et Kodo à la jeune fille du XX° Siècle qu'il a rencontré et qui a
craqué pour eux...
Braves bêtes !
Bref un film à louer, comme j'ai fait, si vous avez un gros abonnement mais
surtout
pas à acheter. o) Et les furets dans tout ça ? Ben ils voyagent toujours dans
le sac de Dar -bien sagement sans avoir l'envie d'en sortir- et sont très
attachés à leur maître, puisque dans un séquence du début l'un des deux
mord au mollet un guerrier adverse à un moment très judicieux (il allait
attaquer son maître par derrière). La scène que vous voyez c'est un bisou
entre un aigle (Sharak) et un furet ! Quand on sait à quel point les rapaces
sont des bourreaux de mustélidés, c'est vraiment une faute de goût... La fin
d'ailleurs, où Dar
donne Podo et Kodo à la jeune fille du XX° Siècle qu'il a rencontré et qui a
craqué pour eux...
Braves bêtes !
|
Scène du film, fin |
Beaucoup d'action dans ce film ; ce qui peut surprendre le plus, c'est la présence des deux furets dans le sac de Dar, qui entre autres y sont ballottés pendant tous ses trajets à poids au long des journées, sac qui est même brinquebalé dans tous les sens dans certaines scènes d'actions. Ici, la logique a rejoint les bases du cinéma, et ce sont des faux furets (poupées à l'image de ceux qui sont sur la couverture vidéo) qui ont étés placés dans ces scènes. Concernant les vrais furets, dans toutes les scènes où les furets attaquent et donnent l'impression de mordre, en réalité ils ont simplement étés entraînés avec des friandises. :-) D'autres questions restent obscures, comme le tournage des scènes à plusieurs animaux : affaire à suivre...
![]()
![]() Dr
DOLITTLE 2 : (1° tiers du film, 5 mn). De la comédie
américaine familiale, aux mécanismes... bon, mais encore une
fois il y a bien pire. Je remercie Mélanie Pilon, du Québec, de
me l'avoir
Dr
DOLITTLE 2 : (1° tiers du film, 5 mn). De la comédie
américaine familiale, aux mécanismes... bon, mais encore une
fois il y a bien pire. Je remercie Mélanie Pilon, du Québec, de
me l'avoir 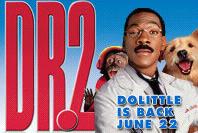 signalé. La référence : Dr Dolittle 2 ;
USA 2001, réalisateur : S. Carr. ; prod. et dist. : 20th Century
Fox ; scope coul., dolby, 82 mn. Les acteurs : E. Murphy, K.
Wilson, ... C'est l'histoire d'un vétérinaire qui a le don de
parler (au sens conversation) aux animaux. En réalité c'est un
remake, mais pas d'un film français pour une fois, mais d'un
film américain des années 60 adapté d'un roman. Le fil conducteur du n° 2, ce
sont les animaux sauvages, auquel est confronté Eddy Murphy :
ours, raton-laveur, opossum, etc... Les critiques de comédie que
j'ai pu lire l'on massacré ! Même pour l'aspect " effets
spéciaux ", pas grand chose à espérer.
signalé. La référence : Dr Dolittle 2 ;
USA 2001, réalisateur : S. Carr. ; prod. et dist. : 20th Century
Fox ; scope coul., dolby, 82 mn. Les acteurs : E. Murphy, K.
Wilson, ... C'est l'histoire d'un vétérinaire qui a le don de
parler (au sens conversation) aux animaux. En réalité c'est un
remake, mais pas d'un film français pour une fois, mais d'un
film américain des années 60 adapté d'un roman. Le fil conducteur du n° 2, ce
sont les animaux sauvages, auquel est confronté Eddy Murphy :
ours, raton-laveur, opossum, etc... Les critiques de comédie que
j'ai pu lire l'on massacré ! Même pour l'aspect " effets
spéciaux ", pas grand chose à espérer.
| Affiche de sortie américaine, 2001 |
La figuration du furet pourrait, elle, faire rire ; on rapporte au vétérinaire une " belette " (VF)... qui n'est autre qu'un furet putoisé (j'ignore les propos de la conversation). Une erreur de doublage ? C'est douteux, tant le doublage est logique et facile de ferret à furet ; bizarre autant qu'étrange... J'ai été sur le site officiel du film (américain), et oh surprise ! Il y a bien un furet dans le casting du site, mais... estampillé weasel(belette) !!! ça se trouve dans le menu " Members cards " (casting). On y voit les différents personnages animaux, par une sorte de carte de membre, avec commentaires et photos. C'est cette image qui serait intéressante de montrer, malheureusement je ne peux pas vous la fournir à cause des formats de fichier (images défilantes), plus que pour des raisons légales (il ne s'agit pas de diffuser un extrait de film en cours d'exploitation). La photo ne laisse aucun doute, c'est bien un furet putoisé, pas une belette, putois ou je ne sais quoi d'autre. Le commentaire dit entre autre : " payé en oeuf de poule ", bien. Qu'est-ce qu'à voulu faire le réalisateur ??? Parler d'un putois non, puisqu'il aurait dit polecat et qu'en plus il n'existe pas dans la faune d'Amérique du Nord. N'importe quoi, j'en ai bien peur ; oui, c'est une comédie, mais ça s'ajoute à beaucoup d'autres images antipédagogiques erronées, et multiplie par plusieurs millions le nombre de gens qui les visionnent... Et quand vous promenez Coco au parc le week-end, vous avez les enfants qui disent " ho, une belette !" A la différence de la télé, les grands studios (warner, Fox, etc.) s'exonèrent de toute responsabilité...
Paradoxalement, on est peu renseigné sur le travail au furet dans le film, tout simplement par sa pléthore d'animaux ! Le film est tellement basé sur la multitude locale d'animaux, que jusqu'à maintenant le furet passe inaperçu dans les sources par rapport aux autres animaux plus présents dans le scénario.
![]()
![]() Polly
et moi
: (2° partie du film, apparitions multiples). Le furet à l'affiche,
ce qu'on n'avait plus vu depuis Dar l'Invincible II ! La référence : Polly et moi ;
USA 2003, réalisateur : J. Hamburg ; prod. et dist. : Universal
; scope coul., dolby, 90
mn. Les acteurs : B. Stiller, J. Aniston, P. S. Hoffman,, A. Baldwin...
(titre original : " Along came Polly ") Le dresseur animalier : Raymond
W. Bill ; les furets étaient fournis par l'entreprise Birds and Animals
Unlimited. C'est une histoire statistiquement improbable d'une rencontre de
couple opposé entre un assureur méticuleux et une bobo étourdie nouveau
marié Reuben Feffer (Ben Stiller)
Polly
et moi
: (2° partie du film, apparitions multiples). Le furet à l'affiche,
ce qu'on n'avait plus vu depuis Dar l'Invincible II ! La référence : Polly et moi ;
USA 2003, réalisateur : J. Hamburg ; prod. et dist. : Universal
; scope coul., dolby, 90
mn. Les acteurs : B. Stiller, J. Aniston, P. S. Hoffman,, A. Baldwin...
(titre original : " Along came Polly ") Le dresseur animalier : Raymond
W. Bill ; les furets étaient fournis par l'entreprise Birds and Animals
Unlimited. C'est une histoire statistiquement improbable d'une rencontre de
couple opposé entre un assureur méticuleux et une bobo étourdie nouveau
marié Reuben Feffer (Ben Stiller) La vie planifiée et "sans
risques" de l'assureur déraille lorsque sa femme (Debra Messing) le quitte pour un instructeur
de la plongée, naturiste latin lover italien (français dans la
version originale). Mais quand il rencontre
son amie d'enfance Polly (Jennifer Aniston) qui comme serveuse distraite qui
mélange du vin rouge avec du vin blanc :-(, elle va l'envoyer dans un
tourbillon des risques : imprévus, nourritures épicées, danses cubaines,
problèmes de répondeurs, etc. C'est autour de ce contraste de personnalités
qu'est construite la comédie, agrémenté d'hésitations et de choix
sentimentaux. Si Jennifer Aniston se sort très bien de son rôle de Polly, en
revanche on a du mal à adhérer au comique grimacier de Ben Stiller pour
Reuben ; à la limite on est plus amusé ou touché par le second rôle de Philip
Seymour Hoffman en Sandy. La première était
surtout connue avant pour Friends, la série télé au succès mondial,
et le second pour la comédie Mary à tout prix ; moins connu, le
réalisateur a été celui de Zoolander et de Mon beau-père et moi
(peu connu en France qui a connu le succès aux USA).
La vie planifiée et "sans
risques" de l'assureur déraille lorsque sa femme (Debra Messing) le quitte pour un instructeur
de la plongée, naturiste latin lover italien (français dans la
version originale). Mais quand il rencontre
son amie d'enfance Polly (Jennifer Aniston) qui comme serveuse distraite qui
mélange du vin rouge avec du vin blanc :-(, elle va l'envoyer dans un
tourbillon des risques : imprévus, nourritures épicées, danses cubaines,
problèmes de répondeurs, etc. C'est autour de ce contraste de personnalités
qu'est construite la comédie, agrémenté d'hésitations et de choix
sentimentaux. Si Jennifer Aniston se sort très bien de son rôle de Polly, en
revanche on a du mal à adhérer au comique grimacier de Ben Stiller pour
Reuben ; à la limite on est plus amusé ou touché par le second rôle de Philip
Seymour Hoffman en Sandy. La première était
surtout connue avant pour Friends, la série télé au succès mondial,
et le second pour la comédie Mary à tout prix ; moins connu, le
réalisateur a été celui de Zoolander et de Mon beau-père et moi
(peu connu en France qui a connu le succès aux USA).
Et bien sûr, déboule aussi dans le film Rodolfo, furet mâle putoisé vieux et miro, censé avoir été " acheté aux puces " et doué pour se cogner partout. En réalité, on ne voit pas plus le furet que dans d'autres films, et avec un rôle bien moindre que dans la série des Dar des Années 80, mais là on a beaucoup plus d'informations communiquées... Certes, là c'est en tant que furet de compagnie, même s'il a été travesti sur plusieurs aspects et que la plupart des propriétaires de furets ont eu du mal à y retrouver les furets qu'ils connaissent... Des vrais furets ont bien sûr étés utilisés pour le tournage, mais en plus il y a eu recours à un un furet mécanique ; l'information est disponible sur le site de l'A.H.A.S. (Animal Human Association Safety) qui a assité au tournage pour accorder le label " aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage " http://www.ahafilm.info/movies/movieratings.phtml et y explique tous les détails techniques (comme marcher en continu au son d'un bruiter ou manger des cacahouètes tartinées aux petits pots pour bébé). Le tout représente une demi-douzaine de scènes avec furet, au fil des rencontre entre et Polly :
| 1) | à la première entrée dans l'appartement : | : il est pris pour un rat et entré dans les toilettes dans un moment de difficulté. |
| 2) | dans la chambre de Polly : | : comme observateur du premier accouplement des comédiens. |
| 3) | dans la cabine du bateau en pleine tempête : | : où il glisse et couine. |
| 4) | dans la rue, en scène multiple : | : oublié à la porte de l'immeuble (avant départ en aéroport), il est retrouvés avec un bipeur de clé, cheminant (vite) dans la rue, puis à l'arrêt en train de manger des cacahouètes par terre. |
| 5) | à la plage dans les Caraïbes : | : il se cogne à un palmier en scène de fin. |
Là dedans, peut-on y reconnaître un furet de compagnie tel qu'on le connaît ? Apparemment non, et pour plusieurs raisons : même aveugle, un furet normal en déplacement ne se cogne pas aux obstacles, ceci va l'encontre de son fonctionnement sensoriel ; un furet ne marche pas dans la rue aussi longtemps en ligne droite et aussi vite que l'on voit dans le film ; ensuite on voit mal en Europe un furet avec pull-over et ce genre de dérive animalière. Et enfin le pire, le problème du "doublage" des bruits de furet, dont toutes les vocalisations, cris et "pout-pout" ont étés remplacés par des sons artificiels mi-cochon d'Inde / mi-cartoon... Donc un ensemble assez peu réaliste ; chose d'autant plus étrange que les bruits normaux de furet auraient étés tout aussi bien dans le même sens de comique de situation, et qu'il est assez facile d'en trouver des enregistrements : choix volontaire ou incurie de l'équipe son ? Au moins, connaît-on les intentions générales du réalisateurs, par la presse comme on le revéra plus bas : "Je savais juste que je recherchais un personnage pouvant posséder un animal bizarre [...]" a déclaré récemment Hamburg. Je n'avais jamais vu un furet réellement utilisé dans un film. "Ils ont fini par nous faire bien marrer, à l'exception de celui qui a mordu Stiller". Cela pose quand même le problème de la possession du furet comme signe de marginalité. Et surtout ça ne nous dit toujours pas pourquoi bon sang de bois, le réalisateur a doublé le furet par ces espèces de bruits de souris ! ;-)
| Mais on aura pas encore tout dit sur ce film... En réalité on a autant parlé du furet par le film lui-même que par les anecdotes de sortie et promotion du film ! Si elle est passée assez inaperçue en Europe en mars 2004, la polémique médiatique autour de la sortie du film en Amérique à l'hiver 2003/2004. La polémique s'est passée dans deux temps. |
|
|
|
Rodolfo, Universal Pictures, 2003 |
ACTE 1 : Ben Stiller "casse" le furet, comme rapporté ici dans le media progressiste Philadelphia Inquirer :
|
Morsures de furet sur le menton de Ben Stiller en tournage Le
comique Ben Stiller a rit tout le trajet vers l'hôpital, après avoir été
mordu par un furet sur son dernier tournage de film. Stiller était filmé
dans une scène pour Along came Polly avec Jennifer Aniston, quand
la créature à fourrure a décidé de le mordre. La morsure a même exigé
une injection anti-rabique. "Nous faisions cette scène finale où je
viens courir après Jennifer et tenir le furet," dit Stiller. "Il
a fait une rotation folle, il s'est littéralement attaché à mon menton
et il n'a pas voulu lâcher." Stiller, qui ne se fera aucun ami au
PETA (association
de militants animaliers, NDT),
ajoute : "leurs dents sont pointues, comme des rasoirs. Je veux dire
qu'ils sont un peu comme des sortes de rats." Philadelphia Inquirer du 27/12/03 (trad. personnelle) |
Ferret bites Ben Stiller's chin on movie set
Philadelphia Inquirer Dec./27th/03 |
Donc Ben Stiller, l'acteur principal,
c'est fait mordre pendant le tournage par le furet qui faisait une scène de fin
de film. Il s'est fait mordre au menton et
le furet est resté accroché ! Il dit qu'il n'avait rien fait ni provoqué le
furet... Et qu'est-ce qu'a fait Ben Stiller après ? Il est allé
à l'hôpital !!! Pas pour se faire poser des points de sutures ou
de la chirurgie lourde, mais pour se faire une injection anti-rabique... Il faut
savoir qu'en dépit des conclusions des enquêtes épidémiologiques, la Rage est
l'un des 3 motifs régulièrement cités par les autorités locales américaines
qui interdisent le furet, avec le danger pour la faune (le furet est exotique en
Amérique) et le danger pour les enfants. Et quand il a raconté ça ça a fait
boulle de neige chez les journaliste, dépêches reprises dans pleins de
journaux... :-( Alors après un tel
tapage en Décembre sur cette mauvaise créature qu'est le furet, les
associations et propriétaires du furet ont répondu massivement dans les
médias, choqués de ce désastre sur l'image des fufus...
ACTE 2 : Ben Stiller s'excuse. Pris à parti dans cette tourmente, Ben Stiller a
bien dû s'expliquer face aux contre-attaques des furetphiles disant que chez
eux leur furet est gentil et ne fait pas ça (et n'est pas enragé, aussi
) ! Interrogé lui aussi, le réalisateur s'est d'ailleurs montré plus ouvert
que son acteur, rappelant les bons moments amusants passés avec le furet sur
le tournage... Acculé dans l'impasse médiatique, Ben Stiller s'est
finalement excusé au mois de Janvier, disant qu'il comprenait les
propriétaires de furets, qui vient normalement avec eux : ouf !!! Ce retournement médiatique est expliqué tout en détail dans cet article du
media conservateur Free Republic :
|
Ben Stiller s'excuse pour avoir offensé les amoureux du furet
Free Republic, 09/01/04 (trad. Stilgar) |
Ben Stiller Apologizes for Offending Ferret Lovers
Free Republic Jan.9th, 2004 |
A noter aussi que selon le site spécialisé FilmStew.com (http://www.filmstew.com), d'après un article de L. Caroll du 15/01/04, que le furet serait exonéré dans cette affaire. D'une part Jennifer Aniston y signale, amusée, qu'elle n'a jamais eu à craindre ce problème de son côté et que le dresseur disait bien qu'il n'était pas mordeur (le furet, pas le dresseur). Et surtout on y apprend que le réalisateur, reportant la faute sur l'acteur, déclare que chacun a sa version de l'incident et que Stiller aurait eu des traces de beurre de cacahouète au menton... :-) Maintenant, l'image du furet restera-t-elle indemne de tout ça ?
On est très bien renseigné sur les détails de réalisation du tournage des furets de ce film, parce qu'il est récent, que des représentants de l'A.H.A. ont bien suivit le tournage, et que la production a manifestement misé sur la communication sur le furet. En complément d'un vrai furet, il y a eu en réalité un recours important à l'animatronique et ses faux-furets. C'est notamment le cas dans toutes les scènes de collision (mur, poubelle, palmier) et dans le tangage de la tempête en bateau. Les vrais furets, eux, ont nécessité un minimum de conseils aux acteurs pour la manipulation (surtout pour J. Aniston) et quelque fois une aide technique, comme dans la longue scène de promenade dans la rue " à marche rapide " où pendant que l'homme fait 1 pas, le furet fait xx pas X4 (les maîtres savent qu'un furet ne tient pas la marche très rapide ;-). Plus classique, pour faire marcher le furet aussi droit et aussi longtemps en fin de film ou pour lui faire croquer des cacahouètes, l'équipe a eu recours au pouic-pouic et aux friandises. Ce qui fait qu'au final, avec un script peu réaliste sur l'action animale on arrive quand même à avoir un enchaînement assez naturel des actions...
![]()
![]() UN
FLIC A LA MATERNELLE : (séquence principale : fin
du film, 15 sec). Bon, de la comédie américaine familiale, mais
dans le genre il y a bien pire... On pourrait même le considérer tout à fait
satisfaisant dans son genre. Le flic à la maternelle, c'est Scharwtzenneger, en mission "décalée". Référence : Un
flic à la maternelle; USA 1990, réalisateur : I. Reitman ;
prod. et dist. : Columbia ; scope coul., dolby, 93 mn.
Acteurs : A. Scharwtzeneger, Linda Hunt, ... (titre original " A kindergarten cop ").
Les dresseurs animaliers : P.
Galabria, K. Dew (qui a travaillé sur les bêtes plus imposantes de La Guerre du Feu). Ici, l'emploi du furet c'est comme
animal de compagnie, l'ami des enfants. En réalité, il n'y a pas une mais
plusieurs apparitions du furet (un
putoisé assez sombre) dans le film, du début à la fin.
Dans le film, Scharwtzy
possède avant ça mission un furet, qu'il trimbale dans sa voiture... En
difficulté dans sa rencontre avec les enfants, il amènera un
furet à l'école pour le montrer aux enfants,
pour faciliter le contact (un grand classique psychologique o). La scène est plus
importante est vers la fin. Pendant le combat final, le
furet attaque
carrément le père
divorcé kidnappeur (c'est un bon fufu, ça, le
mien a plutôt tendance à fuir devant l'adversité °) : depuis le pull du fils
où il était caché, il remonte sur sa manche
UN
FLIC A LA MATERNELLE : (séquence principale : fin
du film, 15 sec). Bon, de la comédie américaine familiale, mais
dans le genre il y a bien pire... On pourrait même le considérer tout à fait
satisfaisant dans son genre. Le flic à la maternelle, c'est Scharwtzenneger, en mission "décalée". Référence : Un
flic à la maternelle; USA 1990, réalisateur : I. Reitman ;
prod. et dist. : Columbia ; scope coul., dolby, 93 mn.
Acteurs : A. Scharwtzeneger, Linda Hunt, ... (titre original " A kindergarten cop ").
Les dresseurs animaliers : P.
Galabria, K. Dew (qui a travaillé sur les bêtes plus imposantes de La Guerre du Feu). Ici, l'emploi du furet c'est comme
animal de compagnie, l'ami des enfants. En réalité, il n'y a pas une mais
plusieurs apparitions du furet (un
putoisé assez sombre) dans le film, du début à la fin.
Dans le film, Scharwtzy
possède avant ça mission un furet, qu'il trimbale dans sa voiture... En
difficulté dans sa rencontre avec les enfants, il amènera un
furet à l'école pour le montrer aux enfants,
pour faciliter le contact (un grand classique psychologique o). La scène est plus
importante est vers la fin. Pendant le combat final, le
furet attaque
carrément le père
divorcé kidnappeur (c'est un bon fufu, ça, le
mien a plutôt tendance à fuir devant l'adversité °) : depuis le pull du fils
où il était caché, il remonte sur sa manche 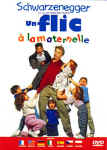 et lui saute au cou
pour le mordre férocement (même si ça reste non sanglant), juste le temps
pour son adversaire de prendre quelques balles. Bref, tout ce dont d'instinct on peut
avoir peur chez le furet ! D'ailleurs, l'internaute (déjà
citée) qui m'a signalé cette scène, m'a aussi rapporté que
des gens ont eu la peur des furets après avoir vu ça... et
certains l'on encore. C'est tout le problème de la
responsabilité du cinéma voire encore plus de la télé, dans
les représentations et l'imaginaire populaire. On va me dire que
la comédie est justement basée sur le décalage entre le réel
et le jeu, d'où humour... mais les résultats sont là.
Comme dans la plupart des films, on
entend le problème
du bruit du furet, qui ressemble plus à celui d'un oiseau exotique... Autres
reproches, on pourrait aussi parler de la contention à une main, ou de la
voiture comme demeure du furet (sic...) ; mais bon, le film n'est pas à
vocation pédagogique et fait "sur" et pas "pour"
l'école.
et lui saute au cou
pour le mordre férocement (même si ça reste non sanglant), juste le temps
pour son adversaire de prendre quelques balles. Bref, tout ce dont d'instinct on peut
avoir peur chez le furet ! D'ailleurs, l'internaute (déjà
citée) qui m'a signalé cette scène, m'a aussi rapporté que
des gens ont eu la peur des furets après avoir vu ça... et
certains l'on encore. C'est tout le problème de la
responsabilité du cinéma voire encore plus de la télé, dans
les représentations et l'imaginaire populaire. On va me dire que
la comédie est justement basée sur le décalage entre le réel
et le jeu, d'où humour... mais les résultats sont là.
Comme dans la plupart des films, on
entend le problème
du bruit du furet, qui ressemble plus à celui d'un oiseau exotique... Autres
reproches, on pourrait aussi parler de la contention à une main, ou de la
voiture comme demeure du furet (sic...) ; mais bon, le film n'est pas à
vocation pédagogique et fait "sur" et pas "pour"
l'école.
| Affiche de sortie vidéo, 1990 |
Comme dans d'autres films, on a utilisé dans la réalisation des scènes au furet des recettes très classiques et très simples. Dans les scènes à immobilité longue, comme celle où le furet était censé rester bien sagement dans le pull de l'enfant, aucune drogue n'a été nécessaire ...puisque réalisées avec une peluche ! Quand à celle de l'attaque du furet, il tout simplement été conditionné par une friandise plus que par le désir d'égorger le kidnappeur !
![]()
![]()
THE BIG
LEBOWSKI : (2° moitié du film, 1 mn). "Ils l'on prit pour un
con... ils avaient raison", disait la bande-annonce ! Les frères
Cohen ne sont pas n'importe qui, réalisateurs du cinéma
indépendant et d'auteur avec un certain succès en France à
défaut des États-Unis. The Big Lebowski a été remarqué par la
critique comme un thriller de qualité (et avec dérision), sans
problème. La référence : The Big Lebowski ; USA 1998,
réalisateur et scénariste : J. Cohen ; prod. et dist. : Pathé ; scope coul., dolby,
mn. Acteurs : J. Bridges (le Duc), J. Goodman, J. Moore, S. Buscemi, P-S.
Hoffman... Pour se mettre dans l'histoire, le
personnage principal joué par Jeff Bridges est un bon gros baba
cool rêveur et un peu paumé pris accidentellement dans un tourbillon d'évènements brutaux et désagréables. Un jour, Jeff rentre chez lui quand deux
malfaiteurs lui mettent la tête dans la cuvette des WC, lui réclamant le remboursement des dettes
de sa femme... sauf qu'il n'a pas de femme ! Les ennuis commencent,
d'autant plus qu'ils ont uriné sur son beau tapis et qu'il va en demander le
remboursement...
de femme ! Les ennuis commencent,
d'autant plus qu'ils ont uriné sur son beau tapis et qu'il va en demander le
remboursement...
| Affiche de sortie vidéo, 1999 |
Le furet comme animal de torture : je n'y avait pas pensé, à celle-là... encore que l'on est pas loin du Ferretlegging. La scène où j'au vu intervenir un furet (complètement par hasard) est aussi singulière que le scénario ; c'est dans la deuxième moitié du film. Le bon gros Jeff est dans sa baignoire quand trois allemands entrent dans la maison, armés entre autre d'une batte et d'un furet ! C'est un furet putoisé bien propre, en laisse/harnais et tout... mais qui n'aime pas l'eau. Son maître le place dans la baignoire, mais pas n'importe où °) ! Bref il se débat dans l'eau en poussant des " kiiiii-kiiiiiiii " de rage, placé dans l'entrejambe de Jeff. Dissuasion suffisante pour que cela en reste à la menace, ses attributs masculins restant en place et les agresseurs singulier repartant (avec le furet à sécher °). Ce qui est curieux, c'est que dans la V.F., on a droit à un "oh, jolie marmotte" !... Une erreur aussi grossière peut difficilement venir d'une erreur de doublage ; hors, qu'est-ce que l'on trouve sur la fiche technique de la V.O. ? On retrouve dans l'équipe technique un certain William Preston Robertson comme responsable "owls" et "marmots" : le problème vient donc de la V.O.... Donc on a bien ici un rôle instrumentalisé du furet, dans un cadre " décalé " ; mais qui est déjà plus proche du réel que les films précédents. Une image de la scène ?
Alors,
quels sont les petits secrets de la scène à la baignoire, avec son tumulte
natatoire en place fixe entre les jambes ? ;-) Hé bien en associant des plans
avec vrai et faux furet ! C'est bien un vrai furet qui a été laissé "
amerrir " dans la baignoire, mais il a été aussitôt repris par le
dresseur. L'agitation de l'eau a elle été faite avec un mannequin de faux
furet.
![]()
DREAMCATCHER,
L'ATTRAPE-RÊVES : (première moitié du film, 30 sec). Le furet chez
Stephen King ? La référence : Dreamcatcher ; USA 2003,
réalisateur : Lawrence Kasdran. Acteurs : Morgan Freeman, Thomas Jane,
Jason Lee, Donnie
Wahlberg.  Le nom du réalisateur ne vous dit pas grand chose ? Ben à moi
non plus, mais avant d'avoir réalisé le gentillet French Kiss, il avait
travaillé comme scénariste sur Le temps des copains et Silverado. Mais l'enjeu essentiel du
film, c'était d'adapter un des romans fantastique de Stephen King, l'auteur
fantastique à succès tellement lu partout dans le monde. Quatre
amis - Jonesy, Henry, Pete et Beaver - se retrouvent chaque année dans un
chalet de chasse ; ils sont liés depuis l'enfance, et notamment depuis qu'ils
ont sauvé un handicapé mental qui leur transmettra un don particulier...
Alors... Bof, alors le problème c'est qu'on ne retrouve pas du tout l'ambiance
d'épouvante et de peurs infantiles d'avec le méchant clown de "Ca"
; le film surprend dans la mesure où l'histoire connaît des développements
qu'on n'imaginait pas du tout au début, mais dans la réalisation de séquence
à séquence les enchaînements sont souvent prévisibles et la réalisation ne
joue pas vraiment sur des peurs psychologiques du "ça" freudien. Il y
a un manque de réalisme et une distanciation qui se crée qui fait que l'on
n'entre pas dans ce film trop plat qui tire trop vers la série B : en un mot,
à part quelques brèves touches de comique, une réalisation ratée ! En plus
le titre pose problème puisqu'il n'engage en rien en réalité par rapport au
scénario (le dreamcatcher finit brûlé assez vite dans l'histoire o) ),
même s'il est effectivement question de passage imaginaire/rêve/réalité
fantastique et de dons surnaturels. C'est quoi, un dreamcatcher ? Ben un
attrape-rêves c'est un talisman indien, qui suspendu dans une demeure,
"filtre" les rêves. A la limite, le plus intéressant du film est
probablement dans le personnage de Duditts, rôle valorisant et protecteur rare
au cinéma pour un handicapé.
Le nom du réalisateur ne vous dit pas grand chose ? Ben à moi
non plus, mais avant d'avoir réalisé le gentillet French Kiss, il avait
travaillé comme scénariste sur Le temps des copains et Silverado. Mais l'enjeu essentiel du
film, c'était d'adapter un des romans fantastique de Stephen King, l'auteur
fantastique à succès tellement lu partout dans le monde. Quatre
amis - Jonesy, Henry, Pete et Beaver - se retrouvent chaque année dans un
chalet de chasse ; ils sont liés depuis l'enfance, et notamment depuis qu'ils
ont sauvé un handicapé mental qui leur transmettra un don particulier...
Alors... Bof, alors le problème c'est qu'on ne retrouve pas du tout l'ambiance
d'épouvante et de peurs infantiles d'avec le méchant clown de "Ca"
; le film surprend dans la mesure où l'histoire connaît des développements
qu'on n'imaginait pas du tout au début, mais dans la réalisation de séquence
à séquence les enchaînements sont souvent prévisibles et la réalisation ne
joue pas vraiment sur des peurs psychologiques du "ça" freudien. Il y
a un manque de réalisme et une distanciation qui se crée qui fait que l'on
n'entre pas dans ce film trop plat qui tire trop vers la série B : en un mot,
à part quelques brèves touches de comique, une réalisation ratée ! En plus
le titre pose problème puisqu'il n'engage en rien en réalité par rapport au
scénario (le dreamcatcher finit brûlé assez vite dans l'histoire o) ),
même s'il est effectivement question de passage imaginaire/rêve/réalité
fantastique et de dons surnaturels. C'est quoi, un dreamcatcher ? Ben un
attrape-rêves c'est un talisman indien, qui suspendu dans une demeure,
"filtre" les rêves. A la limite, le plus intéressant du film est
probablement dans le personnage de Duditts, rôle valorisant et protecteur rare
au cinéma pour un handicapé.
| Photo de tournage, WB 2003 |
 En ce qui nous
concerne, les furets sont dans la scène de fuite des animaux de la forêt. Il y
a un problème ou danger vraiment anormal dans cette forêt, où fuient devant
le chalet toutes espèces mêlées (biches, ours, ratons-laveurs, lapins, loups, etc...), comme
dans Astérix quand Assurancetourix chante dans la forêt ! o) Tournée autour
d'une cabane au Canada blottie au fond des bois, cette scène est évidement le
fruit d'un montage, étant donné les allures d'animaux trop différents pour
obtenir une bonne coordination groupés. Il a été procédé par plans superposés
mais avec le choix de vrais animaux, en réservant les images de synthèses pour
d'autres choses... On voit donc plusieurs furets putoisés et albinos courir
dans la neige avec leur démarche typique de furet ; en réalité, la scène est
monté à partie de quelques furets de séquence originale. Pour faire leur
trajet droit, ils ont étés entraînés " aux friandises ". Mais comme dans l'Ours, on
se demande pourquoi mettre des furets dans la forêt d'Amérique du Nord ? Si
c'était pour figurer des Putois-Pieds-Noirs, on n'est pas dans les Grandes
Plaines ! Il faudrait faire une comparaison avec le texte du livre, ce que je
n'ai évidement pas eu le temps de faire... L'"'animal
trainer" du film est Paul
Jasper (sur les tournages depuis 2000, comme dans Chiens et Chats), sauf
pour les chiens dirigés (à part comme souvent les chevaux) par Ursula
Brauner. Vous
trouverez plus d'infos techniques sur le site français
des studios Warner,
dont la vidéo de "l'exode des animaux" à cette page via
Allociné.com.
En ce qui nous
concerne, les furets sont dans la scène de fuite des animaux de la forêt. Il y
a un problème ou danger vraiment anormal dans cette forêt, où fuient devant
le chalet toutes espèces mêlées (biches, ours, ratons-laveurs, lapins, loups, etc...), comme
dans Astérix quand Assurancetourix chante dans la forêt ! o) Tournée autour
d'une cabane au Canada blottie au fond des bois, cette scène est évidement le
fruit d'un montage, étant donné les allures d'animaux trop différents pour
obtenir une bonne coordination groupés. Il a été procédé par plans superposés
mais avec le choix de vrais animaux, en réservant les images de synthèses pour
d'autres choses... On voit donc plusieurs furets putoisés et albinos courir
dans la neige avec leur démarche typique de furet ; en réalité, la scène est
monté à partie de quelques furets de séquence originale. Pour faire leur
trajet droit, ils ont étés entraînés " aux friandises ". Mais comme dans l'Ours, on
se demande pourquoi mettre des furets dans la forêt d'Amérique du Nord ? Si
c'était pour figurer des Putois-Pieds-Noirs, on n'est pas dans les Grandes
Plaines ! Il faudrait faire une comparaison avec le texte du livre, ce que je
n'ai évidement pas eu le temps de faire... L'"'animal
trainer" du film est Paul
Jasper (sur les tournages depuis 2000, comme dans Chiens et Chats), sauf
pour les chiens dirigés (à part comme souvent les chevaux) par Ursula
Brauner. Vous
trouverez plus d'infos techniques sur le site français
des studios Warner,
dont la vidéo de "l'exode des animaux" à cette page via
Allociné.com.
![]()
LE FURET : (milieu du film, 4 mn). Le furet au temps des films en noir-et-blanc !!! La référence : Le Furet ; France 1949, réalisateur : Raymond Leboursier ; noir et blanc, son mono. Acteurs : Jacqueline Delubar, Jany Holt, Pierre Larquey, Pierre Renoir. Lebousier n'est pas connu pour être un auteur majeur de ce que certains ont appelés l'Age d'Or du cinéma français... Des années 30 aux années 60, il a été producteur et réalisateur souvent de "petits films" et de policiers : donc pas grand-chose de très marquant à part Naïs. Et c'est le cas avec Le furet, qui est un polard (inspiré du roman Crimes à vendre) très satisfaisant : sombre sur le fond et humoristique sur la forme. Le film est vraiment construit autour de Pierre Larquey (acteur sur les mêmes trois décennies dans 200 films dont Knock, Le Corbeau, Quai des Orfèvres, Les Diaboliques) qui joue ici le voyant louche... Le film raconte une histoire de "corbeau" qui annonce des crimes dans des lettres anonymes : pourquoi ? Il signe " le Furet " ; mais il y a aussi un autre furet, tout-à-fait animal celui-ci : un furet empaillé !
| Jaquette de sortie vidéo, 2000 |
 La scène (sur
plusieurs séquences) au furet se passe chez l'un des lieux de meurtres
désigné, chez Jeuniot l'empailleur (après l'hospitalisation du corbeau
"le Furet") ; les enquêteurs débarquent : maison en ville, mais
très rustique... Arrivé de Province récemment, l'homme a une réputation un
peu "originale" et même d'avoir entraîné son chien à tuer les
animaux du voisinage pour se donner du travail ! Il y a toutes sortes de bêtes
empaillées dans sa maison, et notre taxidermiste est en train de terminer un
furet. Rien de trash là-dedans, la naturalisation étant terminée, il en est
au brossage et au vernissage de la planche. Le film étant en noir et blanc, on
peut hésiter à dire s'il s'agit d'un albinos "jaune sale" ou d'un
putoisé clair type cannelle. Dans le dialogue, Jeuniot montre qu'il
connaît l'étymologie latine du mot furet et l'usage de l'animal ; en tout cas
on semblait être à une époque où les gens reconnaissaient un furet,
puisqu'il est désigné comme tel par un enquêteur. Mais bon pour le reste le
furet est assez vilain, empaillé à l'ancienne et artisanalement, tête
inexpressive et gueule ouverte crocs en avant comme on peut trouver avec des
mustélidés de vieilles collections de muséums...
La scène (sur
plusieurs séquences) au furet se passe chez l'un des lieux de meurtres
désigné, chez Jeuniot l'empailleur (après l'hospitalisation du corbeau
"le Furet") ; les enquêteurs débarquent : maison en ville, mais
très rustique... Arrivé de Province récemment, l'homme a une réputation un
peu "originale" et même d'avoir entraîné son chien à tuer les
animaux du voisinage pour se donner du travail ! Il y a toutes sortes de bêtes
empaillées dans sa maison, et notre taxidermiste est en train de terminer un
furet. Rien de trash là-dedans, la naturalisation étant terminée, il en est
au brossage et au vernissage de la planche. Le film étant en noir et blanc, on
peut hésiter à dire s'il s'agit d'un albinos "jaune sale" ou d'un
putoisé clair type cannelle. Dans le dialogue, Jeuniot montre qu'il
connaît l'étymologie latine du mot furet et l'usage de l'animal ; en tout cas
on semblait être à une époque où les gens reconnaissaient un furet,
puisqu'il est désigné comme tel par un enquêteur. Mais bon pour le reste le
furet est assez vilain, empaillé à l'ancienne et artisanalement, tête
inexpressive et gueule ouverte crocs en avant comme on peut trouver avec des
mustélidés de vieilles collections de muséums...
![]()
LÉGENDES D'AUTOMNE :  (1°
moitié du film, 1 mn sur plusieurs plans). Voilà un film aux avis très contrastés
ce
film et aux fans souvent féminins : film romantique ? film sentimental ?
(il y a pourtant des scènes gore contraires aux conventions internationales sur
la guerre) film pour Brad Pitt ? (le fait est que même avec la
présence de Jack Nicholson il crève l'écran)... Une belle atmosphère en tout
cas dans l'ouest américain du début du siècle et un zeste d'indianité ; on
pourrait définir le film comme une sorte de tragédie familiale et de croisements sentimentaux (quand A
est avec B mais que C aime A mais que A aime D o). La référence : Légendes
d'Automne ; USA 1994,
réalisateur : E. Zwick ; coul. Technicolor. Acteurs : Antony Hopkins, Brad Pitt,
Aidan Quinn... A savoir : le dresseur (distinct du dresseur d'ours) est Anne Gordon,
qui a travaillé sur une douzaine de film dont le nom ne vous rappellera rien sauf le bucolique
et romantique Et au milieu coule une rivière. La scène au furet est en 1915
-vers le début du film- quand les 3 frères sont partis à la guerre dans
l'armée canadienne. Il y a un repas et une discussion à la maison du père (ils
rejoignent le repas de leurs employés et parlent de la scolarisation de leur
enfant) et
Isabelle encore enfant (la fille métis de l'employé Decker) a un furet dans
les bras. C'est manifestement un gros mâle, mais qui répond d'après les
dialogues au nom de " Lady
", comme étant la lady de Tristan o), le frère préféré ! Ou
alors si c'est une femelle, c'est un monstre de la nature (parce que les
injections d'hormones et antibiotiques à l'époque, bon o) ...
(1°
moitié du film, 1 mn sur plusieurs plans). Voilà un film aux avis très contrastés
ce
film et aux fans souvent féminins : film romantique ? film sentimental ?
(il y a pourtant des scènes gore contraires aux conventions internationales sur
la guerre) film pour Brad Pitt ? (le fait est que même avec la
présence de Jack Nicholson il crève l'écran)... Une belle atmosphère en tout
cas dans l'ouest américain du début du siècle et un zeste d'indianité ; on
pourrait définir le film comme une sorte de tragédie familiale et de croisements sentimentaux (quand A
est avec B mais que C aime A mais que A aime D o). La référence : Légendes
d'Automne ; USA 1994,
réalisateur : E. Zwick ; coul. Technicolor. Acteurs : Antony Hopkins, Brad Pitt,
Aidan Quinn... A savoir : le dresseur (distinct du dresseur d'ours) est Anne Gordon,
qui a travaillé sur une douzaine de film dont le nom ne vous rappellera rien sauf le bucolique
et romantique Et au milieu coule une rivière. La scène au furet est en 1915
-vers le début du film- quand les 3 frères sont partis à la guerre dans
l'armée canadienne. Il y a un repas et une discussion à la maison du père (ils
rejoignent le repas de leurs employés et parlent de la scolarisation de leur
enfant) et
Isabelle encore enfant (la fille métis de l'employé Decker) a un furet dans
les bras. C'est manifestement un gros mâle, mais qui répond d'après les
dialogues au nom de " Lady
", comme étant la lady de Tristan o), le frère préféré ! Ou
alors si c'est une femelle, c'est un monstre de la nature (parce que les
injections d'hormones et antibiotiques à l'époque, bon o) ...
![]()
MARS ATTACKS! : (fin
du film, 1 sec). Il
me semble que peu de monde l'ai remarqué, mais il y a bien un furet !!! La référence :
Mars Attacks! ; USA 1996,
réalisateur et producteur : T. Burton ;  coul. Technicolor. Acteurs : rien de
moins que Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Rod Steiger,
Tom Jones ! Je n'ai pas encore trouvé le nom du responsable animalier. Tim
Burton n'a pas toujours tout réussit, mais là on a une très bonne parodie des
films du genre, il vaut mieux toujours voir ça qu'Independence Day. Le titre
annonce bien le scénario : les martiens attaquent ! Heureusement, la comédie
donne à cet assaut apocalyptique un côté bien ridicule tant aux petits hommes
verts qu'aux réactions humaines... o) Et le furet dans tout ça ? Rien à
voir avec les caquètements des langages martiens et furets ni avec les
expériences de vivisection qu'ils pratiquent dans leurs soucoupes.... En
réalité c'est à la toute fin du film qu'on voit un figuration de furet.
Après la destruction des envahisseurs, il y a toute une scène allégorique
autour de la Terre sauvegardée. Sous le beau temps on voit bêtes et animaux
reparaître à la vie : biches, oiseaux, etc... dont un furet dans les bras de
la serveuse du Cleopatra Cocktail (toujours attifée en égyptienne à ce moment
là, d'ailleurs). Voilà, c'est tout.
coul. Technicolor. Acteurs : rien de
moins que Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Rod Steiger,
Tom Jones ! Je n'ai pas encore trouvé le nom du responsable animalier. Tim
Burton n'a pas toujours tout réussit, mais là on a une très bonne parodie des
films du genre, il vaut mieux toujours voir ça qu'Independence Day. Le titre
annonce bien le scénario : les martiens attaquent ! Heureusement, la comédie
donne à cet assaut apocalyptique un côté bien ridicule tant aux petits hommes
verts qu'aux réactions humaines... o) Et le furet dans tout ça ? Rien à
voir avec les caquètements des langages martiens et furets ni avec les
expériences de vivisection qu'ils pratiquent dans leurs soucoupes.... En
réalité c'est à la toute fin du film qu'on voit un figuration de furet.
Après la destruction des envahisseurs, il y a toute une scène allégorique
autour de la Terre sauvegardée. Sous le beau temps on voit bêtes et animaux
reparaître à la vie : biches, oiseaux, etc... dont un furet dans les bras de
la serveuse du Cleopatra Cocktail (toujours attifée en égyptienne à ce moment
là, d'ailleurs). Voilà, c'est tout.
![]()
MES NUITS SONT PLUS
BELLES QUE VOS JOURS : (début
du film, 10 sec). La référence :
Mes nuits sont plus belles que vos jours ; France 1989,
réalisateur : A. Zulawski ; coul. Tech. Acteurs : Jacques Dutronc, Sophie
Marceau, François Chaumette... Après l'avoir vu, je comprends mieux pourquoi
c'est une étudiante en Psycho qui me l'a signalé... o) C'est un film disons
...particulier, mais avec Zulawski c'est toujours un peu particulier ; l'auteur
de L'amour braque est connu pour faire des films hystériques, où il va
vraiment chercher au fond de la psychologie de ses personnages tourmentés et
accessoirement aussi où il utilise la sexualité de ses personnages comme  révélateur
psychologique le genre de film européen type qui ne passe pas la censure
américaine (et je ne parle même pas de la distribution au Proche-Orient o). Et
c'est un autre débat dans lequel je n'entrerait pas que de savoir si un film
avec Sophie Marceau est forcément de la daube : je dirais juste que ça dépend
du film qu'on lui propose et que là elle s'en sort plutôt bien. Pour résumer,
le scénario est construit autour de deux personnages paumés qui ont chacun
subit un traumatisme différent pendant leur enfance ; et pendant leur rencontre
-où ils ont la sexualité très bavarde- chacun agit comme un révélateur de l'autre, par de longs dialogues ou
monologues en association d'idées. Et personnellement c'est peut-être là le
défaut du film, qui fait très " théâtre filmé ".
révélateur
psychologique le genre de film européen type qui ne passe pas la censure
américaine (et je ne parle même pas de la distribution au Proche-Orient o). Et
c'est un autre débat dans lequel je n'entrerait pas que de savoir si un film
avec Sophie Marceau est forcément de la daube : je dirais juste que ça dépend
du film qu'on lui propose et que là elle s'en sort plutôt bien. Pour résumer,
le scénario est construit autour de deux personnages paumés qui ont chacun
subit un traumatisme différent pendant leur enfance ; et pendant leur rencontre
-où ils ont la sexualité très bavarde- chacun agit comme un révélateur de l'autre, par de longs dialogues ou
monologues en association d'idées. Et personnellement c'est peut-être là le
défaut du film, qui fait très " théâtre filmé ".
Alors le furet, il est dans un palace de Biarritz ! Plus précisément, il est la propriété du groom de l'hôtel (Salim Talbi), personnage lilliputien au style "particulier". Après avoir fait visiter sa suite à J. Dutronc, celui-ci qui connaît bien les lieux lui demande des nouvelles de " Pips ", le furet. Et le groom de sortir de sa poche un mâle (vu la taille) putoisé qui grimpe sur son épaule. Sans pout-pouter, ça décrédibiliserait l'ambiance. Le but de la scène était probablement de souligner la complicité entre le locataire et les travailleurs du lieu. Il y a aussi un lapin dans le film, mais en peluche... Certains objecteront qu'on peut douter de la vraisemblance de la scène au furet au vu de l'exercice professionnel en hôtellerie ; ce à quoi je répondrais que l'ambiance et les personnages de l'hôtel sont de toutes façon psychologiquement "spéciaux" et sont un peu à mi-chemin entre l'Amour braque et les films de Jeunet et Carrot.
![]()
LA MORT DU
CHINOIS : 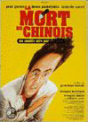 (séquences
multiples). Ce film là, je ne l'avais pas vu moi-même, encore une
référence trouvé par le forum C.F.A.F., cette fois ci grâce à Kolbold
au moment de sa rediffusion sur le câble en août 2003 sur Cinecinema Premier.
Cette comédie était un des premiers rôles de José Garcia, au années de la
grande époque de Canal + avec l'équipe de Nulle Part Ailleurs ;
toujours dans les "produits Canal", dans le film figure aussi
François Morel des Deschiens. La référence : La mort du chinois ; France
1998, réalisateur : J.-L. Benoît ; scope coul., dolby, 80 mn. Acteurs : José
Garcia, Denis Podalydès, Isabelle Carré, François Morel, Tchéky Karyo, Jack Wallace, André
Lacombe. Le
scénario loufoque, c'est celui d'un homme abandonné par sa femme qui est
obsédé par l'idée de tuer son amant, un chinois. Son obsession pathologique
ne va pas rencontre grande opposition que se soit auprès de son ami, de sa
maîtresse, ou de la police... sauf qu'il n'était pas préparé à ce genre de
travail en tant qu'écrivain pour enfants ! o).
(séquences
multiples). Ce film là, je ne l'avais pas vu moi-même, encore une
référence trouvé par le forum C.F.A.F., cette fois ci grâce à Kolbold
au moment de sa rediffusion sur le câble en août 2003 sur Cinecinema Premier.
Cette comédie était un des premiers rôles de José Garcia, au années de la
grande époque de Canal + avec l'équipe de Nulle Part Ailleurs ;
toujours dans les "produits Canal", dans le film figure aussi
François Morel des Deschiens. La référence : La mort du chinois ; France
1998, réalisateur : J.-L. Benoît ; scope coul., dolby, 80 mn. Acteurs : José
Garcia, Denis Podalydès, Isabelle Carré, François Morel, Tchéky Karyo, Jack Wallace, André
Lacombe. Le
scénario loufoque, c'est celui d'un homme abandonné par sa femme qui est
obsédé par l'idée de tuer son amant, un chinois. Son obsession pathologique
ne va pas rencontre grande opposition que se soit auprès de son ami, de sa
maîtresse, ou de la police... sauf qu'il n'était pas préparé à ce genre de
travail en tant qu'écrivain pour enfants ! o).
Dans
les livres de l'imaginatif Michel Passeport (José Garcia), les héros sont des
animaux : et voilà donc notre furet. C'est (ce qui est rare au cinéma) un fufu
albinos qu'il achète sur les quais (le Quai de la Mégisserie est bien connu
des parisiens pour les animaleries depuis des générations) ; puis Michel l'emmène
chez lui (petite cage avec paille, passons...). Ensuite on retrouve l'animal
dans une deuxième série de plans où on le voit en train d'explorer et
faire quelques bêtises (ça tombe bien, c'est une comédie), mais ça tourne à
l'orage après puisqu'il effraye la maîtresse de Michel qui le prend pour un
rat en train de traverser un couloir ; la fin de la séquence est carrément
gore puisque le furet finit tué par erreur d'un coup de feu, avec convulsions
spasmodiques et tout, chapeau au monteur et et dresseur animalier (qui ne figure
pas au générique)...
![]()
L'OURS : (milieu du film, 2 sec). Hé bien pour une fois, on a une figuration de furets dans un film à grand réalisateur ... et en plus qui a du succès (avant Luc Besson, c'était quand même le seul réalisateur français a avoir fait des " blockbusters " au niveau international). Pour les amnésiques, Jean-jacques Annaud c'est : La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, l'Amant, Sept ans au Tibet, Stalingrad , etc... La référence : l'Ours ; France 1988, réalisateur : J.-J. Annaud ; prod. et dist. : Pathé ; scope coul., dolby, 93 mn. Acteurs : Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe. Le film a eu un tel succès et est passé tant de fois à la télévision que je ne rappelle son propos que pour la forme : la star, c'est l'Ours ! Ni documentaire animalier (cris et bruitages artificiels), ni film d'animation (le récit est aussi animal que possible), c'est une fiction sur cet animal. La trame se fait autour du périple de l'ourson Youlk, orphelin par accident. Il va devoir survivre seul et sera sauvé par une rencontre singulière avec un gros ours adulte, lui-même poursuivit par des chasseurs. Le grand mérite du film, outre sa formidable qualité esthétique, c'est de ne pas avoir édulcorer la réalité d'un prédateur (le film est déconseillé au public sensible et aux enfants), avec des combats sanglants ours/chiens et ours/chevaux. La figuration de furet est là aussi très furtive, et fait se poser pas mal d'interrogations...
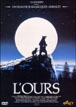 Vers le milieu du film, il y a une scène de chasse où après une cavalcade, le grand ours attrape un cerf dans les fourrés. Pour souligner la force et la puissance de l'affrontement, le réalisateur a voulu montrer comme " témoins de la scène " deux petits animaux, visiblement impressionnés sur leur branche : deux furets ! Le gros plan sur eux ne fait que 2 secondes, il s'agit de deux putoisés. Question : que fichent deux furets dans les montagnes d'Amérique du Nord ??? Moi, je n'en sais rien, et à priori ils n'ont rien à y faire... Il n'existe pas de colonie de furets à l'état sauvage en Amérique du Nord, et ce milieu ne lui est pas favorable. L'auteur a-t-il voulu montrer des putois ? Ce n'est pas un animal d'Amérique. L'auteur a-t-il voulu monter des Furets-pieds-noirs (américains, eux) ? Ils ne vivent pas dans ce milieu, mais dans les grandes plaines, occupés à
boulotter des chiens de prairie dans leur terriers... Bref, je n'y vois pas d'explication logique à cette figuration, peut-être faudrait-il contacter l'auteur o) ? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Vers le milieu du film, il y a une scène de chasse où après une cavalcade, le grand ours attrape un cerf dans les fourrés. Pour souligner la force et la puissance de l'affrontement, le réalisateur a voulu montrer comme " témoins de la scène " deux petits animaux, visiblement impressionnés sur leur branche : deux furets ! Le gros plan sur eux ne fait que 2 secondes, il s'agit de deux putoisés. Question : que fichent deux furets dans les montagnes d'Amérique du Nord ??? Moi, je n'en sais rien, et à priori ils n'ont rien à y faire... Il n'existe pas de colonie de furets à l'état sauvage en Amérique du Nord, et ce milieu ne lui est pas favorable. L'auteur a-t-il voulu montrer des putois ? Ce n'est pas un animal d'Amérique. L'auteur a-t-il voulu monter des Furets-pieds-noirs (américains, eux) ? Ils ne vivent pas dans ce milieu, mais dans les grandes plaines, occupés à
boulotter des chiens de prairie dans leur terriers... Bref, je n'y vois pas d'explication logique à cette figuration, peut-être faudrait-il contacter l'auteur o) ? Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
| Affiche de sortie vidéo, 1989 |
![]()
L'OMBRE
DU VAMPIRE : (1° moitié du film, 50 sec). Les films
d'épouvante et de fantastique : voilà une mine à creuser pour
les figurations animalières au cinéma, et on n'y pense pas forcément ! L'association furet/vampire est amusante, vu les
accusations de vampirisme qui existaient sur le furet. Réf. : L'Ombre
du vampire ; USA 2000, réalisateur : Elias Merhige. Acteurs : W. Defoe, J.
Malkovitch... (titre original : " Shadow of vampire "). Avec ces deux acteurs, vous pouvez vous douter que ce n'est pas un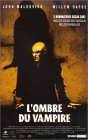 navet ou une série B ! Et ce film a eut deux nominations aux Oscars. Rien de
très horrible visuellement, c'est d'ailleurs plus un film sur la création cinégraphique
(l'histoire se passe sur le tournage de Nofesratu dans l'Allemagne des
Années 20. La scène au furet est très sombre, côté ambiance... et
visibilité. C'est un instant gastronomique où le vampire tient
une cage avec un repas dedans ; le repas ? Un furet ! On n'est
pas loin de la pharmacopée romaine, mais bon on ne le voit pas
manger... Tout est suggéré, dans ce film. ca se passe au début du tournage,
quand l'équipe est en Slovaquie, dans l'auberge. Un inconnu dépose de nuit une cage en bois
avec un furet putoisé ; pas spécialement stressé le furet, puisqu'il se
couche sur le dos en regardant arriver son destinataire ! Destinataire qui n'est
autre que l'acteur de Nosferatu, ont on ne voit que la robe, ses doigts secs et
immenses avec ses ongles de drag-queen (sans la couleur). Au vu de la suite du
film (il mangera une chauve-souris vivante, quel grand acteur ! o), on ne peut que s'inquiéter sur le sort et le bien-être animal de ce
furet... Pour ceux qui n'auraient pas saisi, une nappe est posée sur la
cage...
navet ou une série B ! Et ce film a eut deux nominations aux Oscars. Rien de
très horrible visuellement, c'est d'ailleurs plus un film sur la création cinégraphique
(l'histoire se passe sur le tournage de Nofesratu dans l'Allemagne des
Années 20. La scène au furet est très sombre, côté ambiance... et
visibilité. C'est un instant gastronomique où le vampire tient
une cage avec un repas dedans ; le repas ? Un furet ! On n'est
pas loin de la pharmacopée romaine, mais bon on ne le voit pas
manger... Tout est suggéré, dans ce film. ca se passe au début du tournage,
quand l'équipe est en Slovaquie, dans l'auberge. Un inconnu dépose de nuit une cage en bois
avec un furet putoisé ; pas spécialement stressé le furet, puisqu'il se
couche sur le dos en regardant arriver son destinataire ! Destinataire qui n'est
autre que l'acteur de Nosferatu, ont on ne voit que la robe, ses doigts secs et
immenses avec ses ongles de drag-queen (sans la couleur). Au vu de la suite du
film (il mangera une chauve-souris vivante, quel grand acteur ! o), on ne peut que s'inquiéter sur le sort et le bien-être animal de ce
furet... Pour ceux qui n'auraient pas saisi, une nappe est posée sur la
cage...

LE
SEIGNEUR DES ANNEAUX : (1° moitié du film, 2 sec). A tout seigneur,
tout honneur, et je remercie Xavier d'avoir signalé la référence deux jours
après la sortie du film. On a comparé la sortie du Seigneur des
Anneaux (réputé jusque là inadaptable au cinéma comme l'on disait pour Dune) à celle de Stars Wars
vingt ans plus tôt, par son impact possible dans l'imaginaire d'une
génération... affaire à suivre. Pour l'oeuvre en elle-même, il n'est pas
trop besoin de la présenter : c'est l'adaptation à l'écran de l'oeuvre
de l'universitaire anglais J.-R.R. Tolkien sortie en 1954 (100 millions de lecteurs depuis, c'est pas mal
o), et que l'on considère généralement comme le début du style
Médiéval-Fantastique ("l'Heroic-Fantaisy" des américains). En
tout cas, sa postérité dans le domaine de la littérature et des jeux (jeux de
rôle, jeux de plateaux, jeux informatiques) est incroyablement prolifique : on
retrouve pratiquement le même type de quêtes, d'univers et de personnages dans
certains best-sellers du genre (je pense à Heroe Quest en particulier).
Comme son nom l'indique, le principe du style basé sur l'imaginaire européen
(mais qui a connu le succès aux Etats-Unis) est de mélanger des éléments de la littérature médiévale, de préférence
épique type Matière de Bretagne (Cycle du Graal et compagnie) ou chanson de
gestes, avec des éléments fantastiques soit plus anciens (légendes
celtiques ou scandinaves) soit plus modernes (néogothique du XIX° Siècle et créatures crées
de toutes pièces). Bref, je ne suis pas trop d'accord avec le qualificatif
"d'univers nouveau" ; d'accord, on emprunte toujours (qu'on en soit
conscient ou non) à quelque chose d'antérieur, mais disons que la part de
création pure est quand même beaucoup plus réduite que dans la
Science-Fiction : là, ,on a effectivement des créations pures de choses que
l'on imaginait même pas, et un phénomène spécifiquement contemporain... Au
fait, le nom de Peter Jackson ne vous dit peut-être rien (d'où des
inquiétudes o), mais c'est un réalisateur qui a déjà été " oscarisé
" et (plus rassurant o) a déjà reçu un Lion d'Argent pour Créatures
célestes. La référence : Le Seigneur des Anneaux, épisode I : La
Communauté de l'Anneau ; USA 2001, réalisateur : P. Jackson. Acteurs : E.
Wood, C. Lee, C. Blanchet, ...
suivre. Pour l'oeuvre en elle-même, il n'est pas
trop besoin de la présenter : c'est l'adaptation à l'écran de l'oeuvre
de l'universitaire anglais J.-R.R. Tolkien sortie en 1954 (100 millions de lecteurs depuis, c'est pas mal
o), et que l'on considère généralement comme le début du style
Médiéval-Fantastique ("l'Heroic-Fantaisy" des américains). En
tout cas, sa postérité dans le domaine de la littérature et des jeux (jeux de
rôle, jeux de plateaux, jeux informatiques) est incroyablement prolifique : on
retrouve pratiquement le même type de quêtes, d'univers et de personnages dans
certains best-sellers du genre (je pense à Heroe Quest en particulier).
Comme son nom l'indique, le principe du style basé sur l'imaginaire européen
(mais qui a connu le succès aux Etats-Unis) est de mélanger des éléments de la littérature médiévale, de préférence
épique type Matière de Bretagne (Cycle du Graal et compagnie) ou chanson de
gestes, avec des éléments fantastiques soit plus anciens (légendes
celtiques ou scandinaves) soit plus modernes (néogothique du XIX° Siècle et créatures crées
de toutes pièces). Bref, je ne suis pas trop d'accord avec le qualificatif
"d'univers nouveau" ; d'accord, on emprunte toujours (qu'on en soit
conscient ou non) à quelque chose d'antérieur, mais disons que la part de
création pure est quand même beaucoup plus réduite que dans la
Science-Fiction : là, ,on a effectivement des créations pures de choses que
l'on imaginait même pas, et un phénomène spécifiquement contemporain... Au
fait, le nom de Peter Jackson ne vous dit peut-être rien (d'où des
inquiétudes o), mais c'est un réalisateur qui a déjà été " oscarisé
" et (plus rassurant o) a déjà reçu un Lion d'Argent pour Créatures
célestes. La référence : Le Seigneur des Anneaux, épisode I : La
Communauté de l'Anneau ; USA 2001, réalisateur : P. Jackson. Acteurs : E.
Wood, C. Lee, C. Blanchet, ...
Je vous passe sur
l'intrigue du premier épisode de la trilogie, pour simplement exposer que le
problème du personnage principal (et héros malgré lui) Frodon, de la race des
Hobbits, c'est de gérer le problème de la possession d'un anneau au pouvoir
qui le dépasse, pour le ramener de la Terres du Milieu vers le lieu où il a
été forgé... Ce qui implique la rencontre en chemin d'autres races,
comme les humains, aboutissant à créer une communauté, une compagnie. La figuration de furet
arrive là, dans la ville humaine de La Bree. On y trouve
évidement des auberges (pas
forcément bien fréquentée), comme celle du Poney Fringant
où se passe la scène
qui nous intéresse ; bien fréquentée, la taverne ? En tout cas on y
rencontre des guerriers humains, comme Boromir ou Aragorn. Pourquoi un furet
dans une taverne ? On y voit un putoisé, avec même un gros plan (on voit bien
les dents) ; il est sur l'épaule d'un client qui lui donne une gâterie. En tout cas, 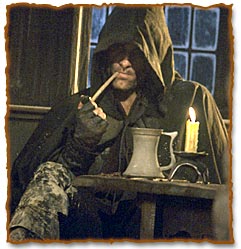 c'est un furet mal éduqué et mal surveillé, il ne
devrait pas se promener sur les tables ! o) On sait simplement que le furet
était possédé par un dresseur local néo-zélandais. Probablement, ça renforce la
rusticité des lieux et c'est probablement la raison de l'emploi du furet dans
cette scène du film. La bonne question serait de savoir si cette figuration est
dans le texte de Tolkien, dans la description de l'auberge, ou bien si c'est une
volonté de mise en scène de Peter Jackson. Indéniablement, le style Médiéval-fantastique sied bien
au furet...
c'est un furet mal éduqué et mal surveillé, il ne
devrait pas se promener sur les tables ! o) On sait simplement que le furet
était possédé par un dresseur local néo-zélandais. Probablement, ça renforce la
rusticité des lieux et c'est probablement la raison de l'emploi du furet dans
cette scène du film. La bonne question serait de savoir si cette figuration est
dans le texte de Tolkien, dans la description de l'auberge, ou bien si c'est une
volonté de mise en scène de Peter Jackson. Indéniablement, le style Médiéval-fantastique sied bien
au furet...
| Intérieur de la taverne, N.L.C. 2001 |
![]()
STARSHIP
TROOPERS : (début du film, 30 sec). La Science-fiction : le furet dans l'espace ?
Non, sur terre, mais on n'en est pas loin
dans cette parodie de film guerrier et SF (et que beaucoup ont
compris et aimé au premier degré °). Diversement interprété, ce film a
reçu avis très contrastés ; en réalité notre cinéaste hollandais a adapté
librement un roman S.F.
américain des Années 50, époque de la Guerre Froide et de films " façon Thems
". On est souvent mal à l'aise dans tous les thèmes brassés
(démocratie, liberté, citoyenneté) autour du militarisme. La référence : Starship
troopers ; USA 1997, réalisateur : P. Verhoven. Acteurs : M. Ironside, Denise Richards... A moins d'être myope comme un furet, je n'ai pas
vu même avec un magnétoscope le responsable animalier au générique, alors
que tout mentionné jusqu'à la restauration ! Il y a juste la mention
habituelle que animaux du tournage n'ont pas étés maltraités.
Ironside, Denise Richards... A moins d'être myope comme un furet, je n'ai pas
vu même avec un magnétoscope le responsable animalier au générique, alors
que tout mentionné jusqu'à la restauration ! Il y a juste la mention
habituelle que animaux du tournage n'ont pas étés maltraités.
Le furet figure comme animal de
compagnie, pas du tout dans la contexte guerrier mais dans le volet antérieur
"vie civile" des personnages principaux. Son nom de scène, c'est
" Cyrano " (V.F.). Semblant vivre en liberté, c'est la furet
de Carl, le "cerveau" du groupe de jeunes recrues. On voit le furet
(un gros mâle putoisé sombre) sortir d'un
tuyau (tout un réseau transparent à côté du bureau) venir prendre une
confiserie de son maître (super l'éducation !). Bien vu, et bien vu aussi
qu'il passe et marche sur le clavier (ça rappelle du vécu, ça) ; ce Cyrano
semble une brave bête qui se laisse caresser sans faire le difficile en tout
cas. Là où il y a problème et une attitude peu naturelle, c'est quand il se
dresse "en chandelle" au lieu de simplement tourner la tête quand son
maître lui parle à sa hauteur, et que par dessus le marché il semble
comprendre ce que lui dit Carl (pour aller monter dans une autre pièce à
l'étage)... Visiblement, le furet regarde derrière la tête du comédien où
doit se tenir le dresseur animalier (on nous la fait pas, à nous o) !)
Techniquement, la scène a été réalisée avec deux entraîneurs, l'un au
point de départ et l'un au point d'arrivée avec un pouic-pouic. Et par
rapport au côté lymphatique de nos boudins à pattes il a l'air assez pressé
de passer d'une pièce à une autre, et tout ça pour obéir au maître et
provoquer des cris d'orfraies de la mère de Carl !

Olivier Cornu © 2001-2004
|
Histoire Naturelle > Le furet dans l'Histoire > Histoire de l'Art > Documentation > Liens > La page d'Ulysse > A propos... |